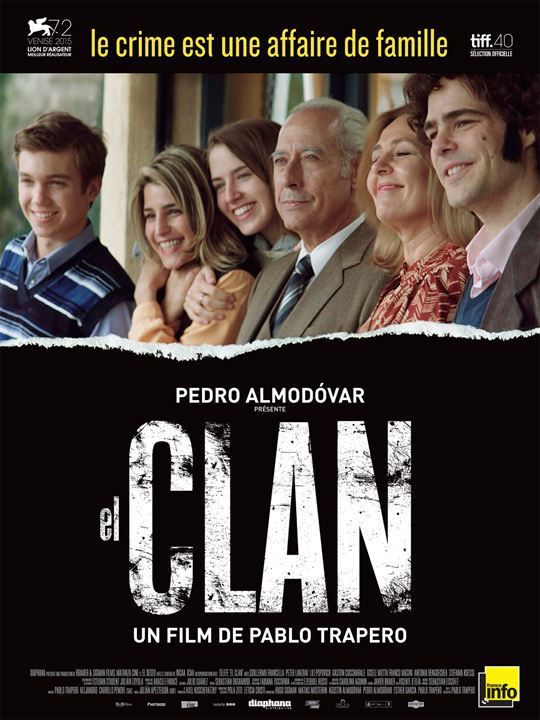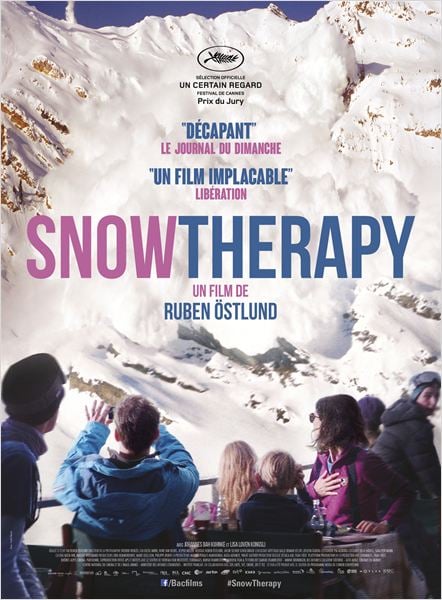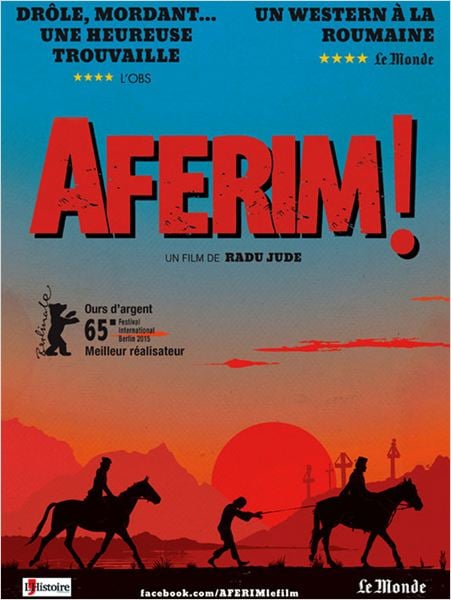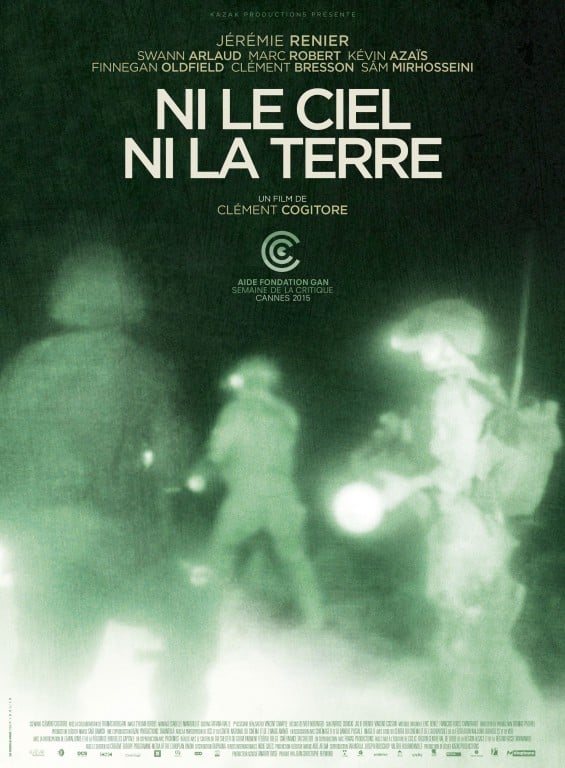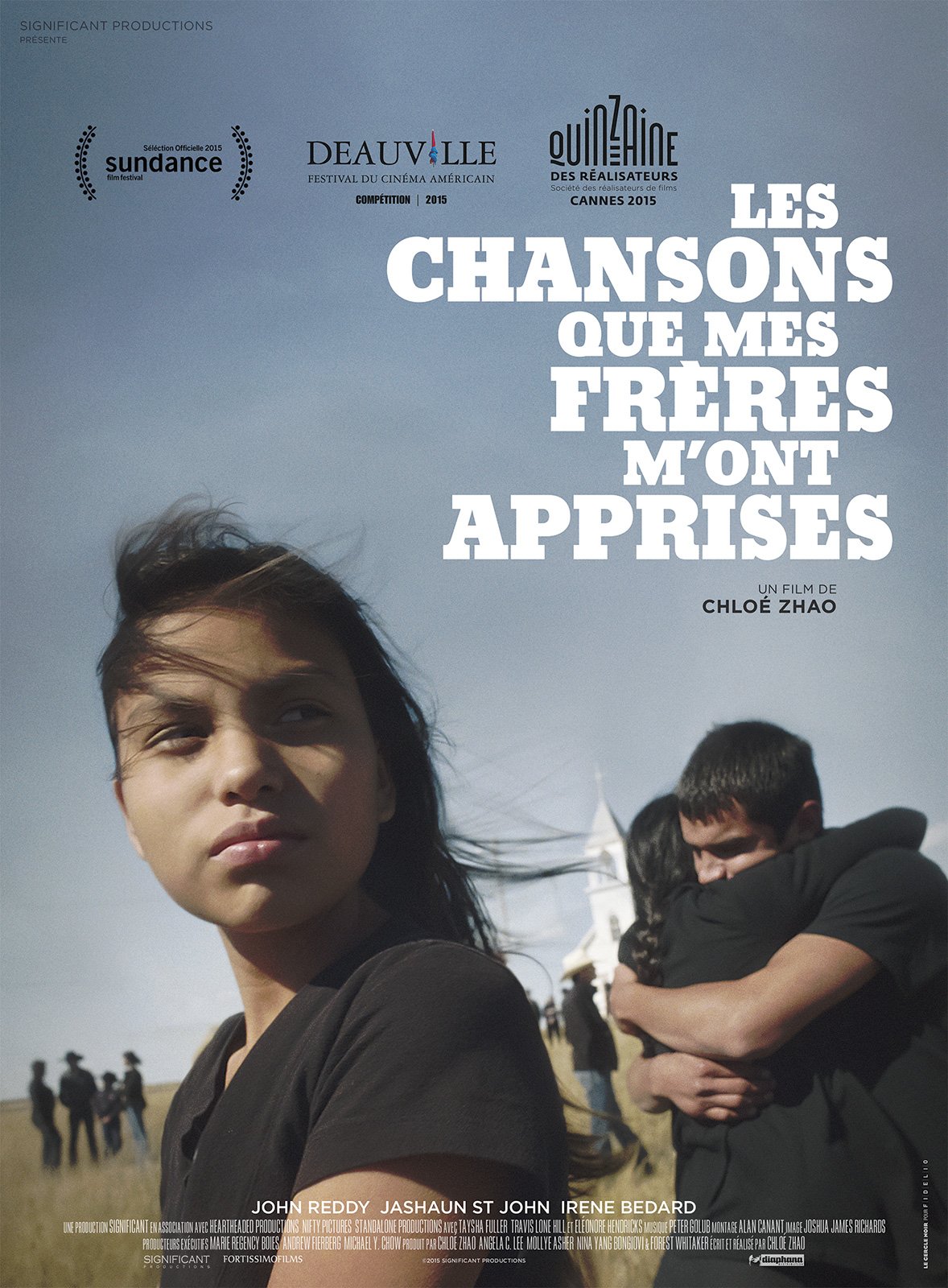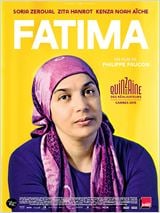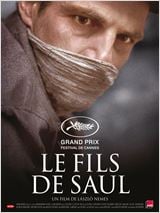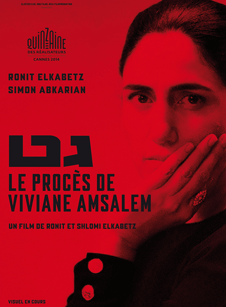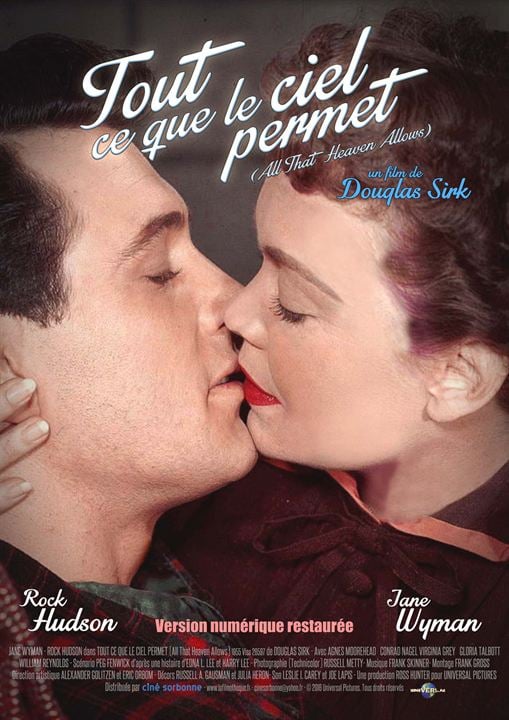Date de sortie 11 novembre 2015

Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride,
Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin,Razane Jammal,
Genre Drame
Production Française
Une histoire de fou a été présenté en Séances spéciales, hors compétition, du Festival de Cannes 2015.
Robert Guédiguian est un habitué du festival puisqu'il a été récompensé par le prix Un certain regard pour son film culte Marius et Jeannette en 1997.
Synopsis
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian ( dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il témoigne du premier génocide du 20ème siècle tant et si bien que le jury populaire l’acquitte.
Soixante ans plus tard, Aram (, jeune marseillais d’origine arménienne, fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie. Un jeune cycliste qui passait là par hasard, Gilles Tessier (, est gravement blessé.
Aram, en fuite, rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans les années 80. Avec ses camarades, jeunes arméniens du monde entier, il pense qu’il faut recourir à la lutte armée pour que le génocide soit reconnu et que la terre de leurs grands-parents leur soit rendue.
Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne savait même pas que l’Arménie existait lorsqu’Anouch (, la mère d’Aram, fait irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander pardon au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre fils qui a posé la bombe.
Pendant que Gilles cherche à comprendre à Paris, Anouch devient folle de douleur à Marseille et Aram entre en dissidence à Beyrouth… jusqu’au jour où il accepte de rencontrer sa victime pour en faire son porte parole.

Entretien avec
Votre film est centré autour du génocide arménien et de ses conséquences. Il aborde des thèmes qui croisent directement vos origines et votre histoire personnelle. Il arrive pourtant tardivement dans votre filmographie. Pourquoi ?
Il y a deux raisons principales. La première, c’est que pendant très longtemps mes préoccupations ont été – comme on disait à l’époque – “internationalistes”. J’étais communiste, internationaliste, et les questions d’identité m’apparaissaient tout à fait secondaires. Importantes mais secondaires. La deuxième raison, liée à la première, c’est qu’à partir des années 90 la thématique de l’identité est devenue extrêmement prégnante. Elle est même passée au premier plan, au point de devenir aujourd’hui le coeur du débat politique en France. Du coup, alors que la gauche ne s’occupait à l’origine pas du tout de cette question, il devenait important que des gens de gauche la prennent à bras le corps. Ce que j’ai fait, à partir de ma propre identité.
Je me sentais obligé, au joli sens très français du terme “Je suis votre obligé”. Car je suis en quelque sorte l’obligé de tous les Arméniens du monde, puisque je m’appelle Guédiguian et que je suis, que je le veuille ou non, ambassadeur de l’Arménie et de cette cause. Avec ce film, j’honore ma responsabilité. J’aurais été Palestinien ou Kurde, j’aurais travaillé la question palestinienne ou kurde. Je suis d’origine arménienne, j’ai travaillé la question arménienne.

Pourquoi la mémoire de ces événements nous est-elle si rarement rappelée, quand elle n’est pas purement et simplement niée ?
C’est le plus ancien des génocides, ce qui explique en partie ce phénomène. Rappelons-nous que le mot génocide n’existait pas à l’époque des faits. On parlait alors d’exterminations de masse, avant que la notion de “crime contre l’humanité” n’apparaisse à la fin de la Première Guerre.
Le concept de génocide a été créé par Raphaël Lemkin au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. En tant qu’avocat stagiaire, Lemkin était au procès de Soghomon Tehlirian, meurtrier à Berlin en 1921 de Talaat Pacha, l’un des responsables du génocide, dont on parle dans le film. Et il avait médité cette question, comme d’autres de cette génération, à l’exemple de Jaurès ou de Gramsci.
Cela étant, tous les génocides, et celui-ci en fait partie, ont les mêmes caractéristiques : il faut bien déporter les gens, donc les regrouper, les exiler, les mettre dans des camps de concentration, trouver des manières pour les tuer…
Mais les génocides ont tous, également, une unicité. Celle du génocide arménien, c’est sa négation. Une négation d’État, la Turquie, avec toutes les armes d’un État en termes économiques, médiatiques, diplomatiques, commerciaux, juridiques. Un État qui mobilise des moyens énormes pour faire campagne depuis cent ans pour nier le génocide partout et de manière directe, organisée et financée.
Vous avez choisi de traiter votre sujet sous l’angle de la fiction. Est-ce qu’un documentaire n’aurait pas été plus approprié pour servir votre dessein ?
Il y a déjà eu un certain nombre de documentaires en français et surtout en allemand, car beaucoup d’archives sont conservées en Allemagne, pays allié de l’Empire Ottoman à l’époque. Certains sont très bien faits, très beaux, bien documentés… Mon choix de la fiction tient au fait que, si j’ai produit plusieurs documentaires, je n’en ai jamais réalisé. C’est une manière que je ne maîtrise pas. Mais l’essentiel demeure que la fiction permet d’universaliser le propos et son impact, si elle est réussie, est un million de fois plus fort.
Le documentaire est sans doute plus juste historiquement et sur le plan théorique, ce que ne peut pas se permettre le cinéma de fiction qui doit rester concret. Mais la qualité première d’une fiction c’est l’incarnation : on fait exister des personnages que le spectateur n’oubliera jamais.
Comment raconte-t-on un génocide au cinéma ? Comment avez-vous abordé l’écriture du scénario et qu’est-ce qui a guidé vos choix de narration ?
Je me disais depuis longtemps que le centenaire approchait et que je ferai un film sur cette histoire, depuis Le Voyage en Arménie, quasiment dix ans. Mais je ne trouvais pas la manière de l’aborder. Raconter le génocide en soi ne m’intéressait pas plus que ça. Ce que je souhaitais, c’était raconter cent ans d’histoire, c’est à dire le génocide et ce qu’il a produit sur plusieurs générations. Je voulais raconter l’histoire de la mémoire du génocide, et plus encore l’histoire de la mémoire de cette histoire ! Et tout cela de manière incarnée.
Et un beau jour, par hasard, je rencontre José Gurriarán. C’est lors d’un Salon du livre. Je le vois arriver sur scène, marchant difficilement avec ses jambes toutes abimées, ses cannes, ses grosses chaussures. Il vient présenter un livre, La Bombe, qui raconte une histoire époustouflante, la sienne. Celle d’un jeune journaliste espagnol qui, en 1981 à Madrid, a sauté sur une bombe posée par des militants de l’Armée secrète arménienne de libération de l’Arménie, l’ASALA. Il a réchappé de cet attentat à moitié paralysé. Et alors qu’il ne savait absolument rien de la question arménienne, et pour s’en sortir, il va vouloir comprendre. Il se met à travailler sur le génocide et sa négation, il lit, il se renseigne, il se documente… Et au bout de ce processus, convaincu que la cause arménienne est juste, il décide de rencontrer les responsables de l’attentat. Après beaucoup d’échecs, parce que ses différents interlocuteurs ont peur, bien sûr, qu’il soit manipulé par les services secrets turcs ou par Interpol… il reçoit un coup de fil : rendez-vous à Beyrouth tel jour à telle heure. Il s’y rend avec un photographe et passe une journée entière à discuter avec deux dirigeants de l’ASALA,(Armée Secrète Arménienne de Libération de l’Arménie) qui vont ensuite l’emmener dans un camp de la Bekaa où il rencontrera ceux qui ont posé la bombe…
Cette expérience a été déterminante. Elle a changé le cours de sa vie…
José Gurriaran a en effet écrit deux livres, La Bombe puis Le Génocide arménien, seul ouvrage sur cette question en Espagne. Il est aujourd’hui le principal militant de la reconnaissance du génocide arménien par l’Espagne, qui continue officiellement de l’ignorer. Chaque année au mois d’avril, il passe beaucoup de temps en conférences sur le génocide. Le principal fondateur de l’ASALA vient d’ailleurs de préfacer la réédition de son livre. C’est une très belle histoire ! Ce n’est pas du tout le syndrome de Stockholm. C’est quelqu’un qui a voulu comprendre avant de juger…
Son histoire m’a donné la clé de mon film, un angle pour entrer dans ces cent ans d’Histoire, en m’apportant en quelque sorte le point de vue du spectateur, de quelqu’un qui, a priori, ne sait rien.

L’expérience vécue de José Gurriaran n’est toutefois qu’un point d’entrée. Votre film est aussi, pour raconter le génocide et ses conséquences, une histoire de famille, de diaspora, de culture déracinée… au fil d’un siècle ?
Oui, parce que dès que j’ai eu ce point d’entrée, je me suis dit que ça ne suffisait pas. Il me fallait une idée qui donne à ce qui n’est qu’une chronique, une dimension plus universelle, de l’ordre de la tragédie. J’ai eu l’idée d’une mère qui pousse son fils à la lutte armée. Une mère très arménienne, mais qui devant l’attentat commis par son fils et l’injustice commise vis-à-vis d’un innocent va tout faire pour aider ce garçon et sauver son fils. Jusqu’à penser qu’il doit toucher du doigt les conséquences de son acte et donc rencontrer celui qui a été la victime de son attentat. Et qui va manigancer une rencontre entre eux deux, jusqu’à une fin tragique qui conduira le jeune homme victime de l’attentat à devenir pratiquement le fils decette femme, son nouveau fils. Quand j’ai eu cette idée-là en plus de l’histoire de Gurriaran, il ne restait plus qu’à écrire !
Vous ne pouviez néanmoins pas faire l’impasse sur les faits génocidaires eux-mêmes. Plutôt que de les faire raconter à vos personnages de fiction ou de recourir à des images d’archives, vous avez choisi un prologue assez original ?
Un génocide n’est pas filmable. Je ne vois pas comment on pourrait filmer des éventrations, des décapitations, des gens qui brûlent sans que ça devienne du spectacle. Sauf, bien sûr, à assumer ce paradoxe absolu qui consisterait à filmer des choses afin qu’elles ne soient pas regardables, à l’instar de Pasolini dans Salo. Alors pour parler du génocide d’un point de vue historique, j’ai réalisé un long prologue qui m’a semblé être une belle manière de raconter cet événement, par la parole. J’ai choisi d’ouvrir le film avec le procès à Berlin, tout à fait emblématique, de Soghomon Tehlirian, le meurtrier de Talaat Pacha, finalement acquitté par un jury populaire alors qu’il revendiquait totalement cet assassinat. Je crois que ce jury populaire a offert au génocide, contre toute attente, la plus belle reconnaissance qui soit, en répondant par non à la question du tribunal : “Est-ce que Soghomon Tehlirian est coupable d’avoir assassiné Talaat Pacha ?” Au sens strict du terme, le jury ment. La réponse est oui, bien sûr, puisque Tehlirian a reconnu avoir prémédité et commis cet acte. Il dit même en avoir ressenti un “contentement du coeur”. Je crois que le jury a simplement voulu dire qu’il était coupable mais pas responsable.
Que le responsable de sa propre mort, c’était Talaat Pacha. Et malgré les exhortations du président du tribunal, le jury n’a pas varié. J’ai choisi ce prologue comme clé d’entrée dans le génocide lui-même mais également parce qu’il me permet de poser la problématique de la vengeance.
Justement, l’attentat que vous mettez en scène, et qui est le pivot du film, est comme un prolongement de l’assassinat de Talaat Pacha. Car même si les actions menées par l’ASALA en Europe dans les années 80 ne s’en prenaient pas – et pour cause – aux responsables-mêmes du génocide, elles visaient à faire payer ceux qui continuent de le nier. Avec pour objectif, selon leurs auteurs, de réveiller la mémoire des pays occidentaux. Ont-ils, en dépit des victimes qu’ils ont engendrées, servi la cause arménienne ?
Oui, incontestablement oui. On est obligé de constater aujourd’hui, quoi que l’on pense de ces attentats et de leur légitimité, que sans eux on n’en serait pas là. Ils ont réveillé, redynamisé, ressoudé les Arméniens du monde entier qui, probablement – et c’est ce que pensaient les jeunes gens à l’origine des attentats – s’étaient un peu endormis sur les commémorations régulières, sans en faire plus. C’est ce que reproche le fils à son père dans le film : on parle un peu arménien, on mange du pasturma, et le 24 avril bien sûr on va à l’église mais ça en reste là. Ces attentats, au fond, aucun Arménien n’était pour, mais aucun n’était franchement contre. C’était “on n’est pas d’accord, mais…” Une attitude un peu schizophrénique.
Tant dans votre film Le Voyage en Arménie, qui abordait déjà le sujet de ce pays, que dans celui-ci, on a l’impression d’un saut de génération en matière de mémoire. En clair, la jeune génération, celle qui nous est contemporaine, semble presque plus préoccupée de se réapproprier l’Histoire de l’Arménie que celles qui l’ont précédée ?
C’est vrai des Arméniens, mais c’est une règle universelle dans toutes les immigrations. Les premiers arrivants ne sont préoccupés que par leur survie. Il faut absolument travailler, apprendre la langue, avoir des enfants et faire surtout en sorte que ceux-ci soient intégrés.
Beaucoup de premières générations d’immigrés vont jusqu’à ne plus parler leur langue, ne pas raconter d’où ils viennent… La deuxième génération en revanche, qui est plus libérée de tout ça, s’interroge et finit par poser des questions. Elle veut savoir d’où elle vient. C’est souvent là que réapparaissent les cadavres, les spectres, les fantômes. C’est souvent eux, ceux de la deuxième ou troisième génération, qui se mettent à revendiquer leur identité première. Et c’est d’autant plus vrai quand c’est une immigration qui est liée à la mort, et ici à une extermination.
Même si votre film n’est pas stricto sensu un film à message ou un film militant, vous y posez un certain nombre de questions qui dépassent la seule problématique du génocide et de sa reconnaissance. Quand le héros, Aram, dit à sa victime : “Tu es innocent mais je ne suis pas coupable”, il soulève la question des limites de la lutte armée et de la légitimité de la violence…
Cette phrase résume bien ce que je pense ! Je suis contemporain de l’ASALA et des attentats des années 80. J’ai condamné en leur temps les pratiques de cette organisation, surtout lorsqu’elles étaient aveugles. Je ne pense pas d’ailleurs qu’il y ait un seul Arménien au monde qui soit d’accord avec l’attentat d’Orly en 1983. Mais je n’étais pas non plus d’accord avec les attentats du FLN dans les cafés en Algérie dans les années 60, dont on parlait beaucoup dans les cours d’école à l’époque.
J’avais déjà abordé ce sujet avec L’Armée du crime. J’ai imaginé une scène où, au risque de leur vie, les partisans ne jettent pas une grenade dans un bordel car il y a de jeunes prostituées françaises, et qu’ils ne veulent pas prendre le risque de les tuer.
Ce n’est pas que je sois angélique par rapport à toute forme de lutte armée, car il y a des situations où elle est nécessaire. Surtout quand aucun autre moyen d’expression n’existe, ce qui était le cas pendant l’Occupation. C’est un peu moins vrai dans le cas des attentats de l’ASALA, car leurs victimes n’étaient pas directement des génocidaires, c’étaient leurs pères et leurs grands-pères. Mais ils appartenaient à ce moment-là à un État fasciste, emprisonnant et tuant dans son propre pays…
Les lieux de tournage ont toute leur importance. Ils donnent une grande vérité au film. On pense notamment aux scènes à Beyrouth…
J’ai tourné à Marseille, en Arménie et à Beyrouth. Je crois que ça compte de tourner sur les lieux authentiques. L’image n’est pas la même. C’est en effet Beyrouth et ce sont des acteurs et figurants libanais. La reconstitution n’était pas de mise. Je voulais les lieux mais aussi les langues, les accents, les lumières, la morphologie de la ville. Même si, dans un cas comme celui-ci, le piège serait de filmer les décors avant la narration car on a très envie de tout filmer. Mais je me retiens ! Il faut être vigilant et toujours s’en tenir à un principe : mettre le récit au premier plan.
Ce qui m’a également intéressé à Beyrouth, c’est le rapport de l’ASALA aux Kurdes et aux Palestiniens. Dans les années 80, la ville était devenue le foyer principal de la Révolution mondiale. Tout ce qui tenait une arme, à gauche ou à l’extrême-gauche, était réuni à Beyrouth à cette époque. On y trouvait aussi des Italiens, des Allemands, l’Armée rouge japonaise, des Irlandais, des Basques. J’aimais bien l’idée d’évoquer cela aussi.
À la fin du film, vous ne tranchez pas. Comme si les choses restaient en suspens. On demeure partagé entre la grande et la petite histoire…
Le dialogue du début du film, entre deux vieux messieurs, au moment où s’ouvre à Berlin le procès de Soghomon Tehlirian, illustre tout ce que j’ai voulu dire. J’ai mis dans la bouche du premier une phrase de l’écrivain israélien David Grossman :
"J’aime penser que les moments les plus importants de l’Histoire ne se produisent pas sur les champs de bataille ou dans les palais, mais dans les cuisines, les chambres à coucher ou les chambres d’enfant."
Et son interlocuteur lui répond :
"C’est peut-être pour cela que les guerres sitôt commencées ne finissent jamais, elles changent seulement de visage. Parce que justement elles restent dans la mémoire de ces gens, ces enfants…". Hélas, je crois que tu as raison",
lui répond le premier. Et à ce moment-là, une jeune mère qui les écoutait s’adresse à son bébé et lui dit : "Ne les écoute pas ces vieux, il n’y aura plus jamais de guerre." Ces quatre phrases résument l’Histoire de l’humanité. Au fond, on a toujours besoin de penser que la guerre qu’on vient de vivre était la dernière, que cette fois c’est fini. Et puis quand la folie des Hommes revient et qu’elle frappe, deux, trois, quatre, dix générations plus tard, le conflit ressort et ça explose à nouveau. C’est toute l’histoire du Moyen-Orient aujourd’hui…
Je voulais donc raconter ces cent ans-là à travers quelques chambres à coucher, quelques salons, avec les personnages qui les habitent… En laissant chacun se faire juge.
Vous n’avez pas peur que cette mesure, cet humanisme, ce que certains appelleront peut-être du "fatalisme” vous soit reproché ?
Peut-être, mais ce sera le fait de gens qui ont une vision simpliste de l’Histoire. Et puis, sans nos actions individuelles et collectives, ce serait encore pire…
J’ai montré le film à des amis, y compris à trois anciens de l’ASALA hier poursuivis, condamnés et emprisonnés, et ils l’ont trouvé juste.
Je pense à cette fameuse tirade de Macbeth : “la vie n’est qu’une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien.”
Tout ça pour quoi, au fond ?
Quand on réexamine effectivement cette histoire, on se dit : et s’il n’y avait pas eu la négation du génocide, si Mustafa Kemal avait fait revenir les Arméniens chez eux, peut-être que la Turquie serait un État démocratique et pluri-ethnique aujourd’hui ? Les dirigeants turcs auraient peut-être abandonné ce rêve absurde d’un État chimiquement pur !
Je ne vois pas d’autre moyen d’exprimer tout cela qu’avec cette expression populaire : c’est une histoire de fou !
Les génocides relèvent de la folie. On trouve toujours des raisons objectives ou pseudo-objectives, mais ça reste des folies absolues, avec de folles conséquences.
C’est donc là l’origine du titre ?
Pas seulement. Je pense également à l’Histoire des Arméniens au fil du XXème siècle, à ce qu’il y a d’étonnant, d’admirable et de presque miraculeux dans ce qu’ils sont parvenus à faire. Voilà un peuple qui a disparu de ses terres, a été dispersé en de multiples diasporas, un tout petit peuple qui aurait pu s’éteindre. Mais ces gens ont réussi, comme des fous, à maintenir deux choses qui sont a priori intenables, psychanalytiquement intenables : oublier pour pouvoir survivre, partout où ils étaient ; et rester fidèles à eux-mêmes, pour être. Oublier à 100% et être fidèle à 100% à la mémoire.
Ça paraît humainement impossible et ils l’ont fait ! Partout où ils se sont installés, les Arméniens se sont formidablement bien intégrés. Il n’y a à ma connaissance aucune forme de racisme à leur égard dans aucun des pays où ils vivent. Et pourtant, sans jamais développer de sentiment ou de comportement communautaristes, ils sont restés fidèles à leur Histoire et à leur culture. Car tout Arménien qui se respecte parle un peu sa langue, connaît la musique arménienne, fait de la cuisine arménienne et va à l’église arménienne, même s’il n’est pas croyant, car ce sont des lieux où l’activité est autant religieuse que culturelle.
Avec ce film vous apportez une nouvelle pierre à la reconnaissance du génocide arménien.
Celui-ci reste pourtant contesté, ou ignoré en tant que tel dans beaucoup de pays. Qu’est-ce qui pourrait faire avancer les choses ? Je pense qu’il faut continuer l’encerclement diplomatique ! C’est-à-dire la pression sur tous les pays du monde. Beaucoup ne l’ont pas encore reconnu, les États-Unis par exemple (à l’exception de la Californie). Parallèlement, il faut continuer la démarche de rapprochement avec la société civile turque. Récemment un sondage a montré que plus de 30% des Turcs de moins de trente ans sont pour la reconnaissance du génocide. Je crois que la génération d’aujourd’hui en a marre, elle a envie de démocratie, de vérité. Il y a une pétition en Turquie, non pour la reconnaissance, parce que c’est condamnable devant les tribunaux, mais qui demande pardon, ce qui est une manière de contourner l’interdit.
Je pense que peu à peu, grâce notamment à internet, la vérité peut se répandre. J’ai rencontré des intellectuels turcs de ma génération qui, et cela peut paraître incroyable, n’ont jamais entendu parler du génocide avant d’être adultes !
Je crois aussi que la reconnaissance du génocide arménien ferait énormément de bien à la Turquie parce que c’est la mère de tous les tabous. Beaucoup de ce qui ne va pas en Turquie, me semble-t-il, procède de ce déni originel.
Qu’aimeriez-vous que les spectateurs retiennent du film ?
Qu’ils aient de l’émotion ! "Émotion", étymologiquement, c’est “mettre en mouvement”. J’aimerais que, grâce à cette émotion, les spectateurs comprennent mieux cette histoire là et, ambition suprême, plus largement, qu’ils comprennent mieux l’Histoire tout court !
Parce qu’évidemment, cette histoire en recouvre bien d’autres. Au fond c’est simple : je voudrais que le spectateur soit plus ému et plus intelligent en sortant de la projection qu’en y entrant. C’est le voeu de tous les cinéastes, non ?

Mon opinion
Une Histoire de fou souligne, avec l'honnêteté qui caractérise Robert Guédiguian, les thèmes de la mémoire, de la rédemption, ceux de la fureur, du châtiment, aussi.
Dès le début du film, dans un somptueux noir et blanc, le réalisateur nous plonge dans les années 1920 au cœur d'un procès qui sera le déclencheur d'un besoin de vengeance et d'une nécessaire reconnaissance de toute une nouvelle génération qui n'était pas née au moment des faits.
Toutes les horreurs meurtrières commises envers le peuple Arménien, tous les tenants et aboutissants du génocide ne sont qu'effleurés. Le réalisateur choisit la fiction pour éviter le documentaire " une manière que je ne maîtrise pas" précise Robert Guédiguian. Son film s'appuie néanmoins sur l'histoire de José Antonio Gurriarán. Un journaliste espagnol blessé accidentellement au cours d'un attentat, commis par l'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie en 1982 à Madrid.
"Les morts d'innocents, ne seront pas les derniers" clame un des chefs, a Dans notre actualité, et pour d'autres raisons, ces mots prennent aujourd'hui une dimension particulièrement douloureuse.
Ce film reste pour moi d'une grande valeur éducative. Le réalisateur précise "La qualité première d’une fiction c’est l’incarnation : on fait exister des personnages que le spectateur n’oubliera jamais." En cela le pari est gagné. Essentiellement grâce à un casting exceptionnel. À la musique originale signée par Alexandre Desplat, aussi.
Ariane Ascaride est magnifique dans un rôle d'une profonde humanité. Robinson Stévenin, dans une participation, aussi courte soit-elle, est particulièrement convaincant. À noter aussi une belle découverte avec l'étonnant et charismatique Syrus Shahidi. À leurs côtés, et Grégoire Leprince-Ringuet participent grandement à la réussite de l'entreprise.


/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_19b413_une-histoire-de-fou.jpg)
/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_c75a96_une-histoire-de-fou.jpg)
/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_ca89c1_une-histoire-de-fou.jpg)
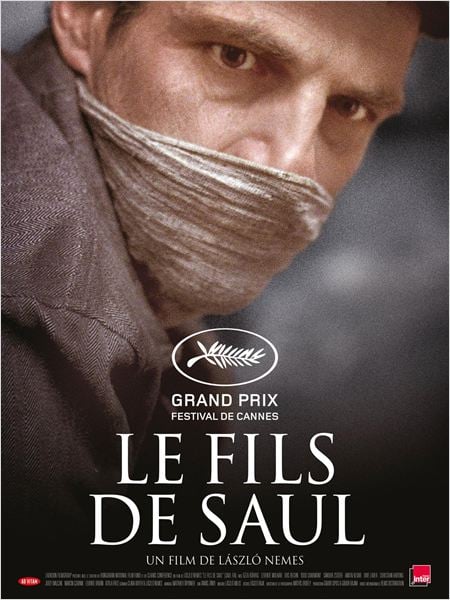














/image%2F1387651%2F20151027%2Fob_b03a1a_c-mikiya-takimoto-9-03.jpg)
/image%2F1387651%2F20151027%2Fob_d11c76_c-mikiya-takimoto-8-03.jpg)







/image%2F1387651%2F20151027%2Fob_ba541a_mon-roi.jpg)
/image%2F1387651%2F20151027%2Fob_0d7b56_mon-roi.jpg)
/image%2F1387651%2F20151027%2Fob_a5c2f0_mon-roi.jpg)