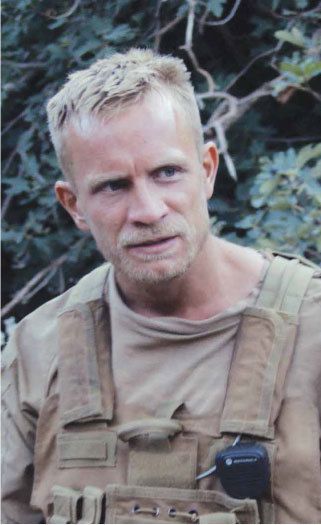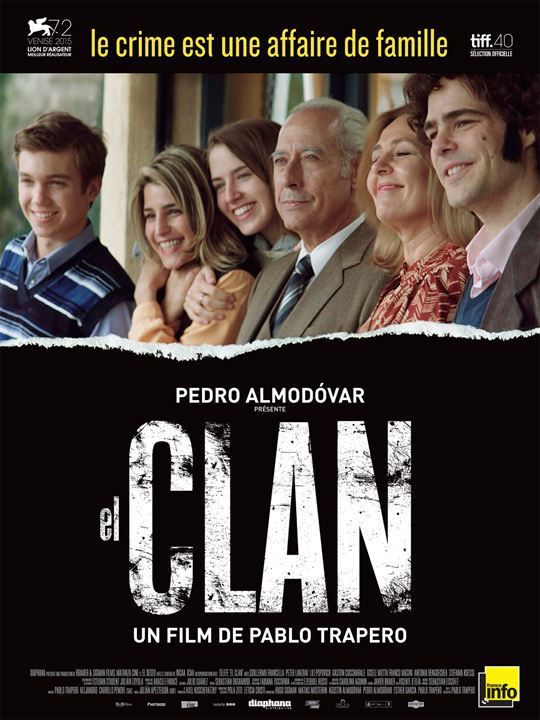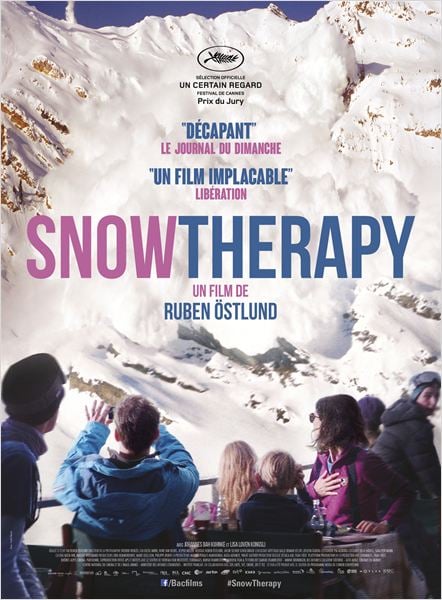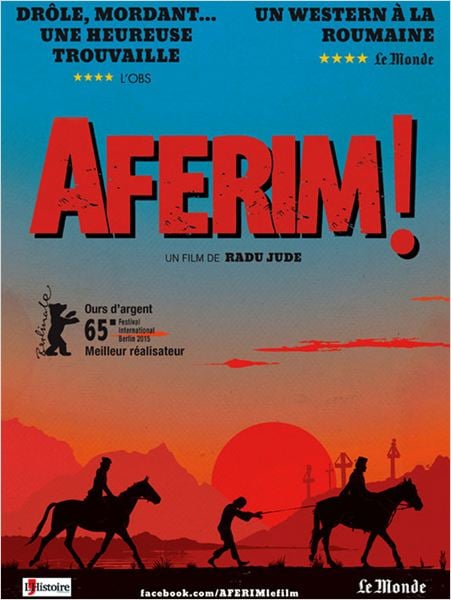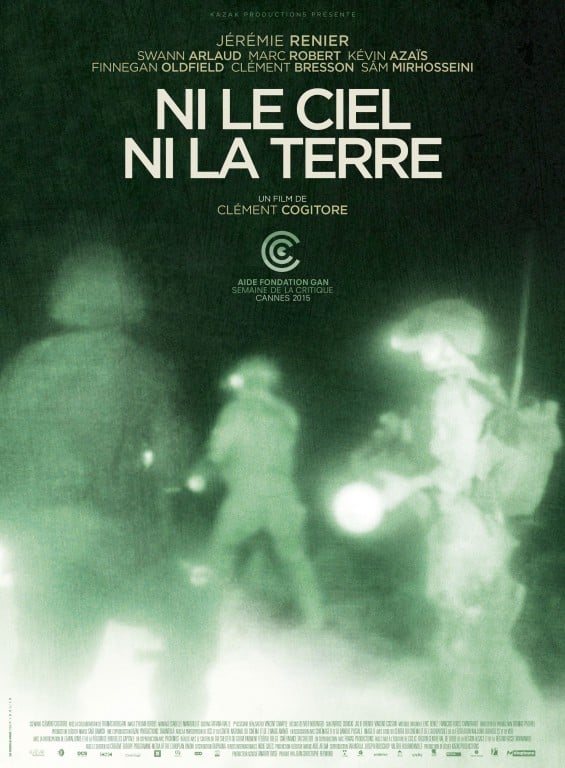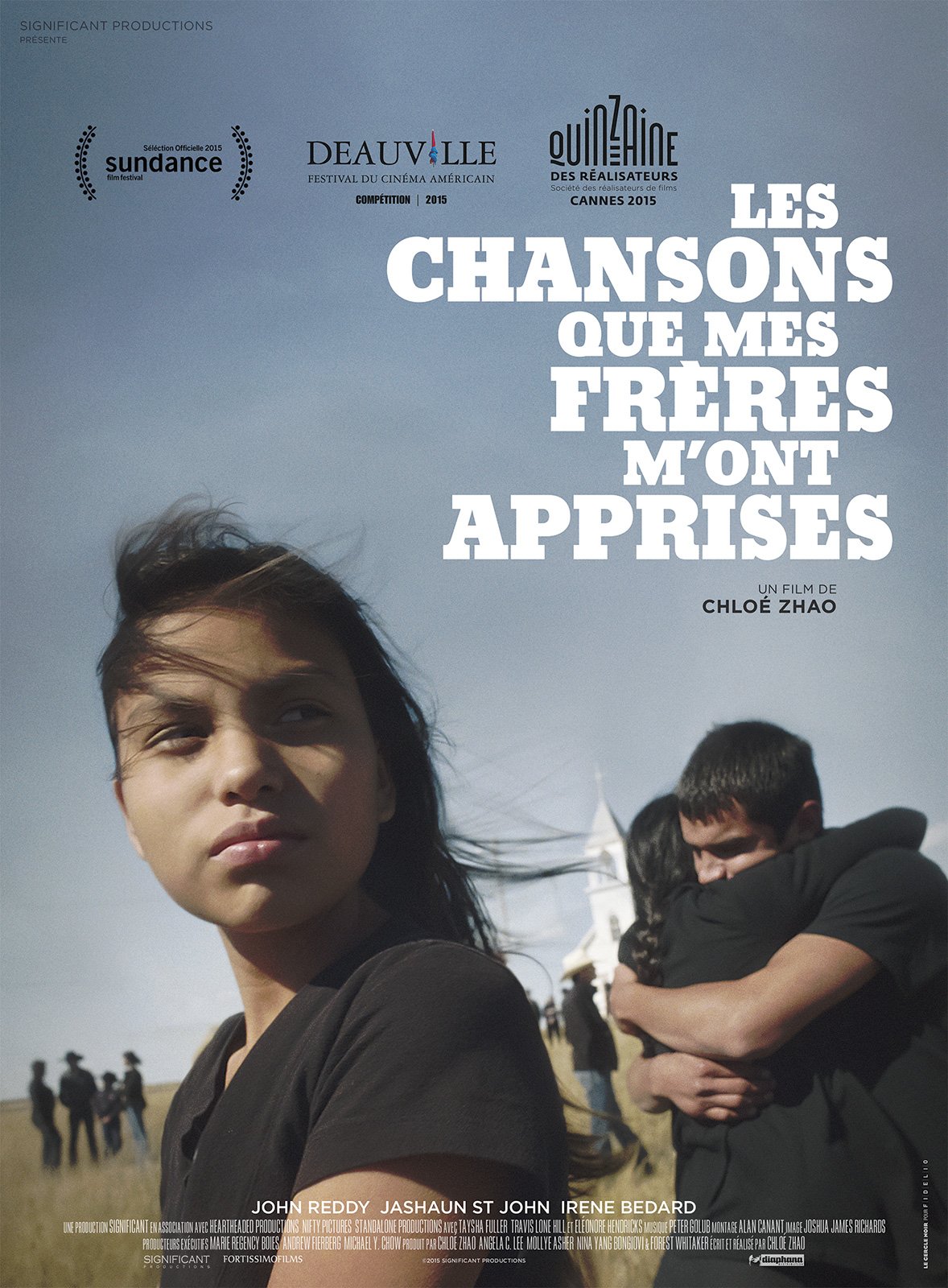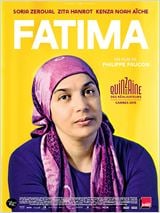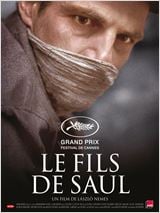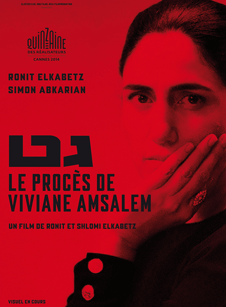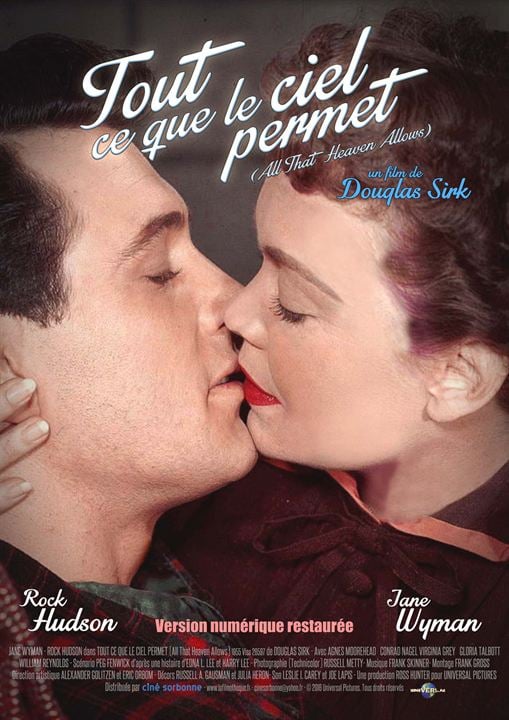Date de sortie 30 septembre 2015

Réalisé par Gilles Legrand
Avec Olivier Gourmet, Georgia Scalliet,
Dimitri Storoge, Hélène Vincent, Fred Ulysse, Michel Robin
Genre Drame
Production Française
Synopsis
Eté 1918.
La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles ( et Angèle (, elle est déjà finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au front son grand amour, le père de sa petite fille.
Unis par le besoin de se reconstruire, ils nouent une complicité joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l'insistance de Charles, Angèle accepte un mariage de raison. Il leur faudra entrer en guerre, contre eux-mêmes et contre l'autre avant d'accepter l'évidence de la passion qui les lie malgré eux…
 .
.
Entretien réalisé en mai 2015 avec le réalisateur, Gilles Legrand.
Propos relevés dans le dossier de presse.
Gilles Legrand, à l’origine de L’Odeur de la mandarine, êtes-vous parti du contexte historique, des personnages ou du thème de la sexualité ?
Depuis longtemps, il y avait cette envie de m’approcher de la thématique de l’intimité du couple et du désir charnel, de m’interroger sur la chimie des corps, de parler frontalement de sexualité : vaste programme où il est très facile de se noyer… Par ailleurs les envies de film viennent chez moi souvent d’assemblage d’éléments ou d’univers très hétéroclites !

Et donc, dans un tout autre domaine, je nourris une véritable passion pour le "meilleur ami de l’homme", le cheval ! Pas vraiment le côté hippique, course, équitation, mais l’animal en lui-même, son esthétique, son élégance et la sensualité qu’il dégage. J’aime l’observer, le toucher, le sentir, l’écouter … tout sauf le manger ! Bref, les chevaux font partie de ma vie, d’ailleurs je vis avec eux. Et depuis un certain temps, je cherchais avec la complicité de mon ami Jean Louis Gouraud, hippiatre de renom, (éditeur, romancier, journaliste, aventurier…) à mettre un cheval au centre d’une histoire.
Il me faisait remarquer comment l’homme ou la femme abordent de manière très différente ces créatures cent fois plus puissantes que nous. Animal qu’on dirige en le chevauchant et dont le contact s’établit principalement entre les jambes, ce qui est loin d’être anodin ! La femme le fait généralement avec douceur, confiance, intelligence, tandis qu’à travers les siècles, l’homme a plutôt cherché à le dominer pour en faire un outil de travail ou partir guerroyer. Moins en douceur, quoi… Je simplifie mais il y a de ça !
Mais un film c’est comme toujours une histoire de personnages, alors j’ai voulu raconter une singulière histoire d’amour avec du cheval tout autour …
En le transposant en 1918…
La mission du cinéaste, c’est d’éteindre la lumière et de vous raconter une histoire. Pour cela, j’ai besoin de m’extraire de mon univers quotidien, besoin de me déplacer –dans le temps et/ou dans l’espace. Dans Tu seras mon fils, c’était l’univers viticole; dans Malabar Princess, une nature assez hostile; dans La Jeune fille et les loups, une autre époque. Et là, encore, on est projeté un siècle en arrière, à la fin de la première guerre dans un contexte mortifère très particulier, avec ce besoin de renaitre et de survivre. Revenir à la nature dans un lieu clos, entouré de forêt. Ça m’a paru plus simple et plus efficace de mettre cette distance par rapport à notre quotidien pour faire vivre et observer ce couple…
Comment êtes-vous passé de ces idées générales à ces personnages très construits ?
Comme j’ai beaucoup de mal à écrire seul – le matin j’écris des pages que je mets le soir à la poubelle – je suis allé chercher Guillaume Laurant, dont j’apprécie le travail, et je lui ai fait part de mes réflexions hétéroclites et en vrac, sur la sensualité de l’animal, l’envie de huis clos et cette histoire d’amour un peu tordue de désir contrarié.

Et ça a résonné chez lui. En discutant, on s’est donc vite fixé sur 1918 et ces deux personnages principaux : un officier de cavalerie unijambiste et une infirmière fille-mère, deux personnages que la guerre a rendus bancals, lui ayant perdu une partie de sa virilité, sa raison de vivre, et elle son grand amour. Comment ces deux-là vont-ils parvenir à se reconstruire ?
Très vite, Guillaume Laurant a écrit une première mouture du script, qui n’est pas si éloignée du film tel qu’il est aujourd’hui, et nous avons ensemble affiné le scénario final.
À travers la figure du cheval, il s’agissait donc bel et bien de parler plus généralement de la sexualité des hommes et des femmes.
Hou là… le terrain est glissant. Un étalon, c’est un étalon : un animal qui n’a pas beaucoup d’autres objectifs que de se reproduire, un animal aux désirs instinctifs extrêmement puissants. Il est très séduisant mais lourdement chargé de symboles. Chacun y voit ce qu’il veut, une métaphore, un catalyseur, un miroir ou juste un moyen de s’évader et retrouver des sensations. Tout n’a pas besoin d’être justifié, surtout là, il faut faire gaffe...
Pourquoi faire gaffe ?
On en vient à l’un des thèmes essentiels du film, l’opposition entre notre propre part d’animalité et d’humanité. Bien sûr, les personnages sont sensibles ou perméables à l’univers qui les entoure mais ils ne se comportent évidemment pas comme des animaux ! Les pulsions masculines peuvent être très fortes... les féminines aussi d’ailleurs. Mais si elles sont déséquilibrées, ce qui est le cas dans notre histoire, alors le couple peut très vite se détruire. L’orgueil de chacun des protagonistes va creuser le fossé… A qui la faute ? Mais je me méfie de mon discours, parce que le regard que le film porte sur le désir est un regard masculin, qui plus est à travers un personnage diminué, handicapé, qui a donc à reconquérir une part de sa virilité. J’espère que le public féminin sera sensible à cette dimension. De plus il n’y a pas de généralité à en tirer, cette histoire et ces personnages ont leur singularité. L’important est seulement de comprendre leurs motivations et leurs trajectoires. En fait pour moi c’est une démarche très intime d’aborder ces thématiques, j’espère avoir réussi à les montrer, mais je ne sais pas vraiment en parler …
 .
.
Le film exprime également une réflexion très subtile sur le rapport féminin au désir.
Je l’espère. Ça passe peut être par l’écriture mais aussi beaucoup par l’interprétation de la comédienne et forcément par le point de vue. Très peu de gens ont pu le voir pour l’instant, mais j’ai pu observer la gêne de certains hommes devant certaines séquences, parce que la caméra y adopte le point de vue de la femme dans des scènes dites d’amour. C’est pour cela aussi qu’il était très important pour moi d’avoir le regard féminin de ma monteuse, Andréa Sedlackova. Elle m’a souvent rassuré, en me disant "Insistons sur cette séquence, c’est exactement ce que la femme peut percevoir face au désir ou au plaisir d’un homme."
Le motif clef du film, cette dialectique homme/femme, animalité/humanité, s’exprime à travers Angèle, le personnage joué par Georgia Scalliet. De sa générosité à soigner l’autre va naître, dans un premier temps, une belle amitié. Mais une fois que le désir survient chez Charles (Olivier Gourmet), comment fait-on pour transformer cela en histoire d’amour ? On peut comprendre que cette fille-mère, en rupture avec sa propre famille, se laisse séduire par l’intelligence, l’hospitalité et la sensibilité de ce type, jusqu’à être prête à faire don de son corps. Mais le jour où elle passe dans son lit, ça coince… Le thème de la jouissance féminine, ce n’est pas que ça m’obsède, mais ça m’interpelle, oui.
Que représente la figure du cerf, l’autre animal au coeur du film ?
Faut-il tout justifier ? Le cerf, c’est l’animal le plus sexué de la faune sauvage. Il est libre, puissant, dominant. À la fin de l’été, dans toutes les forêts de France, plein de gens restent des nuits entières simplement pour écouter le brame, qui est l’appel des biches. C’est très émouvant et angoissant ! Si, au sein des animaux domestiques, l’étalon rime avec puissance et élégance, le cerf est son pendant dans la vie sauvage. Angèle est peut être fascinée par cet animal parce qu’elle entend dans son cri la complainte de son propre mari, une sorte d’appel. C’est un peu laborieux à expliquer… c’est en fait une poésie toute personnelle ! J’ai conscience de pouvoir égarer certains, j’espère que d’autres y seront sensibles !

Situer le film en 1918, c’est aussi se poser la question de la place de la femme au sein de la société française ?
C’est un moment de bascule, où a sans doute commencé un lent processus d’émancipation, qui se poursuit encore aujourd’hui. D’abord, parce qu’il y a eu des millions de morts parmi les hommes : les femmes ont été amenées à prendre la maîtrise des familles, de l’industrie, à s’intéresser aux affaires, à diriger les fermes. Elles sont sorties de leurs carcans, les corsets sont tombés, les jupes se sont raccourcies… Le personnage d’Angèle est éminemment moderne. Je ne suis pas historien, mais c’était effectivement intéressant d’envisager la question de la sexualité dans un tel contexte. Je pense d’ailleurs qu’on n’a pas inventé grand-chose depuis des siècles sur cette question-là …
Vous mettez en scène un monde clos, tout en parvenant à faire ressentir la guerre et l’environnement de l’époque.
La guerre, on l’entrevoit grâce à quelques plans lointains du front, et on s’est efforcé de la faire vivre au son, avec le bruit constant des canons à l’arrière-plan. On a aussi ceux qui viennent du front, mais on n’y va pas. Le lieu fermé est un choix affirmé qui répond à plusieurs considérations.
 On aurait pu partir sur l’idée d’un film d’époque épique. Mais outre les questions économiques, on avait envie de se concentrer sur le sujet, davantage que sur le contexte. Par ailleurs, tourner dans un décor unique, c’est très pratique pour lui donner de la consistance, pour le faire vivre à l’écran.
On aurait pu partir sur l’idée d’un film d’époque épique. Mais outre les questions économiques, on avait envie de se concentrer sur le sujet, davantage que sur le contexte. Par ailleurs, tourner dans un décor unique, c’est très pratique pour lui donner de la consistance, pour le faire vivre à l’écran.
Ce lieu fait partie de l’histoire et il est prépondérant pour créer l’atmosphère. Le repérage de ce château a été fait très minutieusement (toutes les différentes pièces, la cour et les points de vue pour s’observer, les écuries mais aussi ce cheval qu’on cache à l’intérieur du château…), et il y a eu ensuite de très importantes interventions du décorateur Jean Rabasse et de son équipe pour répondre aux exigences du scénario. Ce lieu devait être impressionnant sans être trop étouffant.
Et puis, il y a quelques échappées belles dans les forêts qui ponctuent le récit et qui correspondent au besoin de cette jeune femme de partir s’échapper, respirer, revivre.
Une des particularités du film est le point de vue partagé entre les deux personnages principaux.
Si une femme avait mis le film en scène, peut-être aurait-elle encore davantage insisté sur le personnage féminin… C’est toujours une question qui se pose quand on réfléchit au découpage de chaque séquence. Soit on prend le parti d’épouser un point de vue unique, soit on se laisse un peu plus de liberté. Ici, comme il s’agit d’une histoire d’amour à deux, aucun ne devait être exclu. Il fallait pouvoir aller de l’un à l’autre, choisir selon les moments. Ils ont tour à tour des comportements intéressants qu’il faut savoir saisir. Il y a l’actif, le passif, le dit, le non-dit, celui qui prononce le petit mot de trop, celle qui fait le petit geste qui blesse – je pense à ce moment où Angèle se précipite vers sa bassine pour se rincer juste après s’être donnée. Là, on ressent clairement la souffrance de Charles, qui la regarde tellement pressée de se laver de lui… Après, forcément, chez le spectateur masculin ou féminin, ça va jouer. Il y a même un troisième point de vue, celui du metteur en scène, la caméra se fait extérieure et les regarde se dépatouiller : on voit alors deux orgueils qui s’affrontent et immanquablement se détruisent… Ensuite, dans le calme de la salle de montage, on alterne assez naturellement, il s’agit de chercher le bon point de vue au bon moment.
Et comment abordez-vous les scènes d’amour ?
C’est définitivement ce qu’il y a de plus difficile à tourner. On a tous une forte dose de pudeur à surmonter. Il faut d’abord des comédiens généreux et là j’ai vraiment été très soutenu. On en parle un peu avant avec eux pour ne pas se mentir mais pas trop, pour éviter la pression. On leur fait confiance …Mais heureusement les séquences étaient justifiées et les personnages avaient de vraies choses à faire passer et pas seulement simuler le plaisir … Ensuite créer une ambiance la plus confortable possible, ne pas trop montrer tout en cherchant le détail et laisser l’imagination travailler, rester très près des corps et des visages, tourner en plan séquence et être mobile. Ce fut la méthode adoptée et elle a plutôt bien fonctionné. Mais honnêtement je préfère demander à une comédienne de traverser un étang en nageant avec son cheval à la poursuite d’un cerf …
Un mot sur le titre, L’Odeur de la mandarine ?
Ah ah ah ! Au départ, il s’est imposé parce qu’il était justifié par une scène. Mais le film aurait tout aussi bien pu s’appeler "le Bruit des sabots" ou "le Goût du sel". Il y avait l’envie d’évoquer les sens, d’être dans le registre de la sensualité. Et puis la scène a disparu au montage, mais comme le titre plaisait, il a survécu.

Mon opinion
Au cœur de la première guère mondiale, deux êtres se trouvent et s'affrontent.
Un cadre unique et magnifique, à la limite du front, servira de décor à cette rencontre. Les seuls rappels, du conflit qui fait rage, seront ponctués par le bruit lointain des canons.
Lui, meurtri à jamais dans ses chairs. Elle, le cœur brisé par un amour trop tôt disparu, ne se départira jamais d'une incontestable liberté. Un couple improbable avec un premier point commun l'amour des chevaux.
L'excellent Olivier Gourmet face à une belle révélation au cinéma, Georgia Scaillet. Tous deux portent le film de bout en bout.
Les dialogues entre les deux principaux protagonistes sont souvent joyeux, parfois ironiques, un rien libertins, toujours parfaitement écrits. La complicité du début virera vers une relation quelque peu attendue. "Le thème de la jouissance féminine, ce n’est pas que ça m’obsède, mais ça m’interpelle, oui." a déclaré Gilles Legrand.
Il sera également question d'absence, de reconstruction et d'acceptation. La réalisation reste sage et fait la part belle à la nature, aux animaux. Aux chevaux en particulier. De très belles images, et des passages trop oniriques, desservent quelque peu la véritable histoire des personnages.
À noter de grands comédiens dans de simples participations, Dimitri Storoge, Hélène Vincent, et Michel Robin


/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_1a4033_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_ef357f_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_d87b20_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_ceed0b_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_e58335_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_7dadc2_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)
/image%2F1387651%2F20151008%2Fob_2f0338_l-odeur-de-la-mandarine.jpg)

















/image%2F1387651%2F20150928%2Fob_db4807_lamb.jpg)
/image%2F1387651%2F20150928%2Fob_27f400_lamb-2-1.jpg)