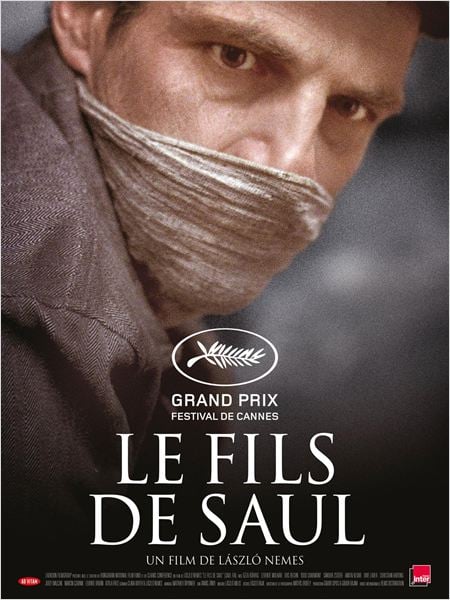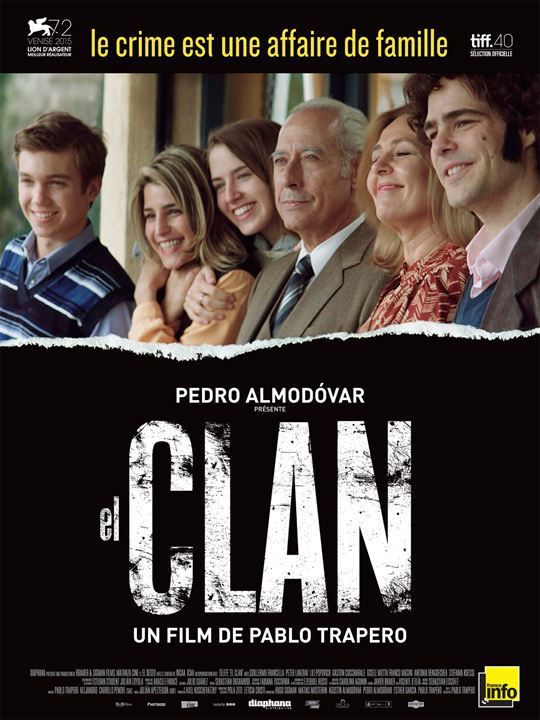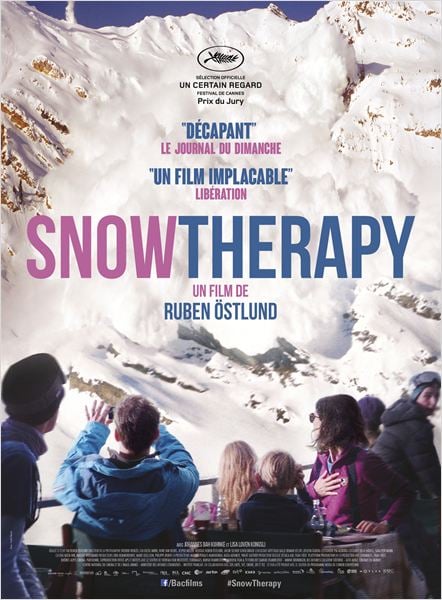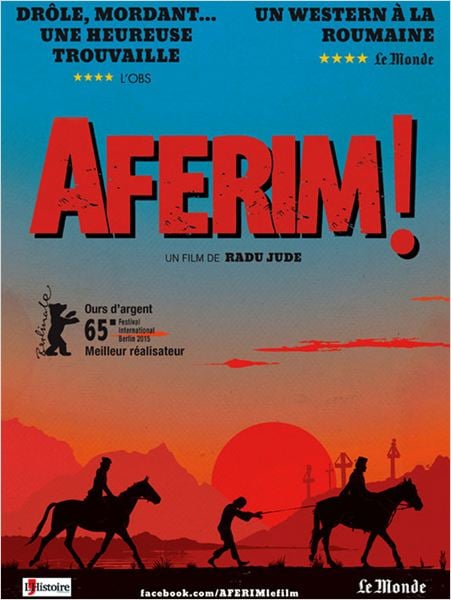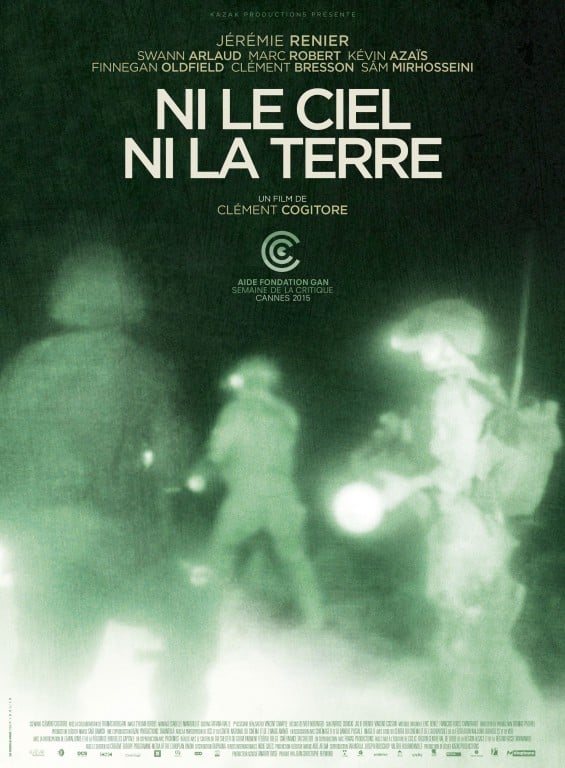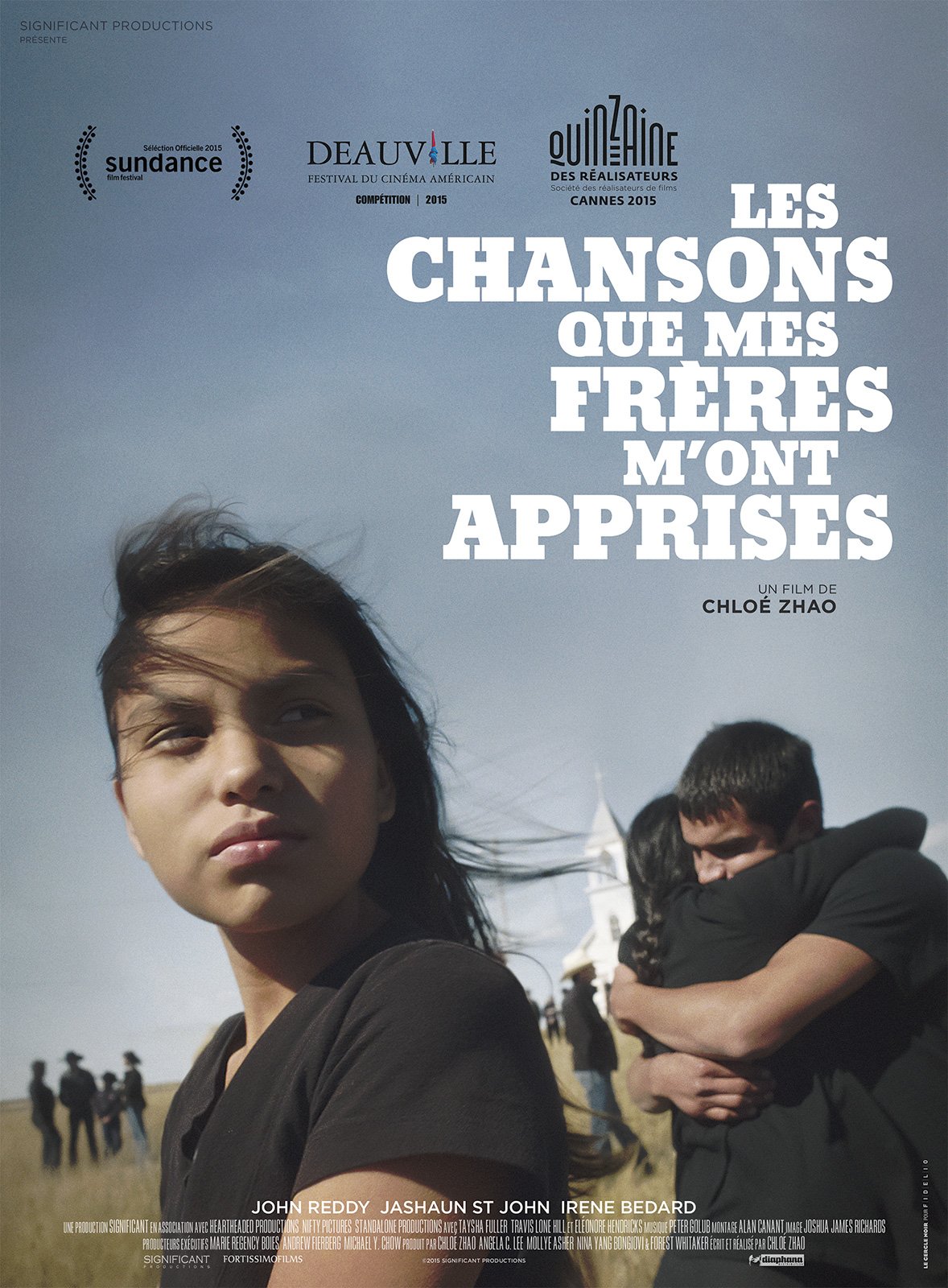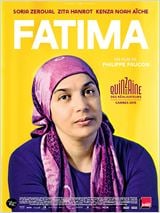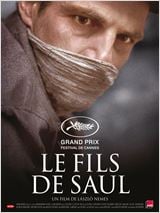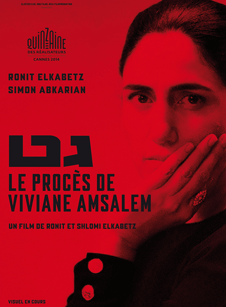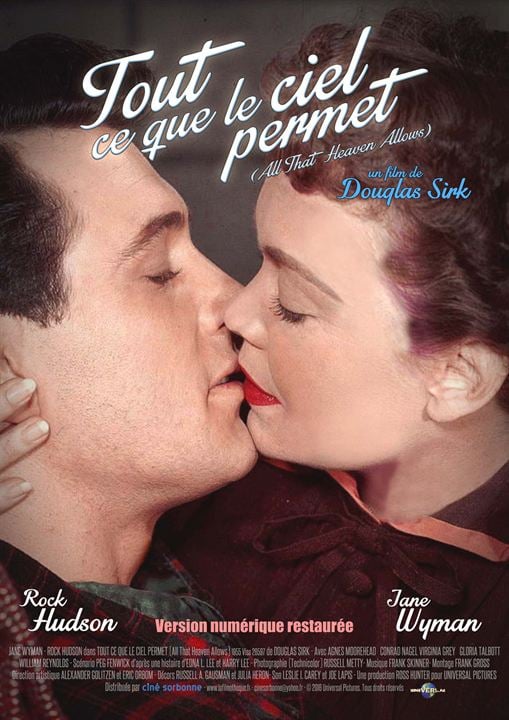Date de sortie 18 novembre 2015

Réalisé par Laurent Larivière
Avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Anne Benoit,
Laurent Capelluto, Nina Meurisse, Nathanaël Maïni
Genre Drame
Production Française, Belge
Réalisateur et scénariste, a réalisé six courts-métrages, sélectionnés et primés en festivals (Belfort, Pantin, Villeurbanne, FID Marseille, Hors-Pistes Beaubourg, Rotterdam…). Il crée également des images pour le théâtre et la danse.
Présenté dans la catégorie Un Certain Regard au Festival de Cannes 2015 Je suis un soldat est son premier long-métrage.
Le réalisateur s'est déjà fait un nom avec ses courts et moyens-métrages, dont les plus connus J’ai pris la foudre en 2006, et Les larmes en 2010 ont été très remarqués. "N'ayant pas fait d'école de cinéma, les court-métrages ont été le lieu de mon apprentissage. Dans chacun d’eux, il est question d’une libération : il s’agit toujours pour le personnage principal de résoudre une énigme intime qui lui permette d’accéder à une conscience nouvelle. Mais dans l’héroïne affronte pour la première fois le monde réel. Je progresse." déclare Laurent larivière.
Synopsis
Sandrine (, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère (, vendeuse dans une grande surface à Roubaix.
Sans emploi, elle accepte de travailler pour son oncle ( dans un chenil qui s’avère être la plaque tournante d’un trafic de chiens venus des pays de l’est.
Elle acquiert rapidement autorité et respect dans ce milieu d’hommes et gagne l’argent qui manque à sa liberté.
Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir.

Extraits de l'entretien relevé dans le dossier de presse avec le réalisateur
Je suis un soldat traite d’un sujet très contemporain.
J’avais envie de parler de la honte sociale et de ce sentiment d’échec qui pousse quelqu’un à revenir dans le giron familial après avoir tenté, sans succès, de se construire un avenir meilleur ailleurs. Dans le film, loin du refuge escompté, la famille devient paradoxalement le lieu d’un affrontement et d’une déperdition.
La famille de Sandrine est elle-même porteuse de la honte que vous évoquiez : Martine, la mère, vendeuse dans un supermarché, est victime du harcèlement de sa très jeune supérieure, qui la tutoie et la rudoie. Audrey, la soeur, est une modeste employée de mairie et son mari, multiplie les CDD sans espoir d’embauche.
Tous sont victimes du déterminisme social auquel la jeune femme a tenté d’échapper et son retour parmi eux rompt l’équilibre qu’ils ont fondé autour du fantasme de sa réussite. Absente, elle manquait - comme tous ceux qui partent, elle était "l’enfant préféré" - revenue, elle attise les frustrations.
Dès la première scène, lorsque Sandrine rend les clés de la chambre de bonne qu’elle occupait en essuyant les réflexions humiliantes de l’agent immobilier, on sent la violence intérieure qui anime la jeune femme ; une violence encore aggravée par l’accueil que lui réserve sa mère : elle est heureuse de revoir sa fille mais n’a ni temps ni place pour elle.
Sa mère part travailler et sa chambre de jeune fille est occupée par sa soeur et son beau-frère. Elle l’accepte et se résigne à dormir sur le canapé. Mais toute cette tension rentrée, cette solitude extrême dans laquelle se trouve le personnage est en permanence contrebalancée par l’amour, réel, qui circule dans cette famille. Aucun de ses membres n’est d’une seule pièce.
Cette ambivalence est presque la source du malaise grandissant de l’héroïne…
Durant la majeure partie du film, Sandrine répond aux désirs des autres. Il n’y a pas de place pour elle ? Elle l’assume. Lui fait-on comprendre qu’elle doit trouver du travail ? Elle en cherche. Son oncle lui propose-t-il une place dans son chenil ? Elle s’en accommode. Et se trouve embringuée dans un trafic d’animaux. Elle suit son oncle : en cherchant à satisfaire ses proches et à se reconstruire en leur sein, elle s’autodétruit peu à peu.
À aucun moment, Sandrine ne se pose des questions face à la façon dont sont traités les chiots exportés illégalement de Slovénie et de Pologne via la frontière belge.
Sandrine ne se préoccupe pas de morale. Par exemple, elle ne considère jamais ou presque la violence faite aux animaux : comme s’il s’agissait de l’ordre des choses, d’un mal nécessaire. Pour elle comme pour beaucoup d’autres, nécessité fait parfois loi.
Peu de gens connaissent ces trafics qui font le bonheur des animaleries.
Je les ai moi-même découverts un peu par hasard. Avec François Decodts, mon coscénariste, nous ne voulions pas que ce soit le sujet du film mais un cadre qui nous permette de suivre au plus près la trajectoire de nos personnages en faisant écho à leur propre violence. Cependant c'est une réalité très cruelle et très prolifique. J'ai lu un article dans le journal Libération où, selon WWF, le trafic d'animaux domestiques ou sauvages se situe au 3ème rang mondial des trafics après celui de la drogue et des armes. Il représenterait 15 milliards d'euros.
;
Et la France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre d'animaux domestiques avec notamment 8 millions de chiens... Et seuls 150 000 chiens des 600 000 vendus chaque année en France proviendraient d'un élevage français déclaré. Ça laisse de la marge pour les importations des pays de l'Est où il existe de véritables usines à chiots.
Au-delà de cette réalité, le trafic est devenu pour nous une sorte d'allégorie de la cruauté contemporaine.
En s’imposant peu à peu dans le monde exclusivement masculin et marginal que fréquente Henri, son oncle, Sandrine finit par ressembler à ces hommes et se met à organiser parallèlement son propre trafic.
L’aurait-elle fait si Henri ne s’était pas montré si violent après qu’elle a acheté des chiots en mauvaise santé qu’il lui demande de rembourser ? Sans doute pas. En faisant cela, Sandrine pense gagner sa liberté. Mais elle fait le mauvais choix. Ce qu’elle prend pour son salut n’est qu’un pas de plus vers l’autodestruction. Sandrine se bat sur tous les fronts – contre ses origines, contre les circonstances et contre la réalité du monde- mais elle ne dispose que d’armes fragiles. Seuls, son instinct et sa force intérieure finiront par triompher de la confusion dans lequel elle se débat à ce moment précis. Comme si pour elle, le monde était doté d'une hostilité de principe.
Elle pourrait saisir la main que lui tend Pierre, le vétérinaire. Il est amoureux d’elle, est le seul à la regarder vraiment et à percevoir son mal-être.
Mais elle ne le fait pas. Elle ne peut ni recevoir son désir, ni entendre ce qu’il lui dit : sa solitude l’enferme dans une spirale implacable. Elle ne peut que retourner la violence contre ellemême. Elle l'accumule, par strates : c’est le ratage à Paris et le retour, moins léger que prévu, puis la violence des affaires auxquelles elle est mêlée et l’horreur de ces animaux morts que son oncle lui demande de brûler. À cela s’ajoute encore, la brutalité de l’intervention des douanes sur l’autoroute, et le fait que son oncle manque de l’étrangler. Elle pourrait tout arrêter, elle n’en a pas la force. Ce n’est que parvenue à un point de non retour, et alors qu’elle a perdu tout espoir, qu’elle peut enfin espérer se trouver... et se sauver. Oui, c’est comme un rite de passage. En frôlant la mort, elle comprend que la reconnaissance de son existence ne peut passer que par elle et non par sa famille : les liens sont également des entraves. Cette idée illustre aussi - qu'il faut parfois mourir à soi - même pour commencer à exister et à dire "Je ".
Le film est entièrement construit autour de ce paradoxe.
 Tous les personnages de cette famille, y compris celui d’Henri, ont une épaisseur, une densité et une complexité à laquelle je tenais beaucoup. Malgré leurs difficultés et malgré leur ambiguïté, ils sont capables d’amour et de solidarité. Une simple partie de cartes entre la mère et ses filles devient tout à coup un moment de joie qui permet d’affronter la perspective du lendemain.
Tous les personnages de cette famille, y compris celui d’Henri, ont une épaisseur, une densité et une complexité à laquelle je tenais beaucoup. Malgré leurs difficultés et malgré leur ambiguïté, ils sont capables d’amour et de solidarité. Une simple partie de cartes entre la mère et ses filles devient tout à coup un moment de joie qui permet d’affronter la perspective du lendemain.
Ce ne sont pas des miséreux, ils se battent, ils sont vivants et ils ont des désirs.
Ils peuvent également être enclins à de violents accès de désespoir, comme dans cette scène magnifique où le beau frère de Sandrine se met à démolir les murs de la maison qu’il ne parvient pas à terminer.
"Comment font les autres ?", hurle-t-il. Sandrine parvient à le calmer en entamant à son tour les fondations de la construction. Elle lui sert d’effet miroir. Et vice-versa. Car c'est une délicate question posée à Sandrine qui s'en sort dorénavant en trafiquant. D'où une seconde interrogation qui en découle : "Jusqu'où est-on prêt à aller pour trouver une place dans la société ?". Leurs situations se font écho, chacun y apportant des réponses différentes.
Martine, la mère, interprétée par Anne Benoit, incarne très bien les contradictions des protagonistes : elle est aimante et droite, résignée à son sort tout en s’accommodant des petits arrangements de son frère et en fermant plus ou moins consciemment les yeux sur ce qui arrive à sa fille…
Martine balance perpétuellement d’un mouvement à l’autre. Elle est affectée par le manque de confiance de Sandrine qui lui a caché ses difficultés et profondément bouleversée par ce qu’elle apprend sur son frère. Mais elle ne peut jamais se résoudre à trancher complètement. Elle reste toujours dans une certaine ambiguïté. Anne Benoit lui confère une sensibilité, une fragilité et une porosité inouïes.
Sa présence apporte beaucoup de douceur et de contraste au film.
Quoique tendu, assez noir et âpre, je ne voulais pas qu’il soit d’une seule couleur. Il fallait ménager des respirations, introduire de brefs moments de répit. La violence qui court tout du long n’empêchait pas certains moments de grâce.
Henri, qui se conduit comme une sorte de « parrain » dans cette famille, est un formidable personnage de film noir.
Il est plein de zones d’ombres : à la fois rude, égocentrique et manipulateur, mais aussi attachant et réellement lié à sa famille ; un lien assez brutal – il la "tient" en glissant des billets aux uns et aux autres. Henri est finalement le seul à ramener concrètement Sandrine à la réalité de son échec. "Pourquoi partir ? Tu vois bien ! Tu es revenue !", lui répond-t-il lorsqu’elle lui demande s’il n'a jamais songé à tout quitter. Il n’a aucune empathie, aucune capacité à voir l’autre. Il utilise sa nièce comme un soldat : c’est elle qui frotte, c’est elle qui porte les sacs, et c’est elle qu’il envoie au front pour faire fructifier son trafic.
Il entretient des rapports presque incestueux avec sa soeur et sa nièce.
Dès l’écriture du scénario, il était clair pour moi qu’Henri et Martine avaient une relation un peu trouble. Mais je ne voulais rien appuyer, c'est à peine si j'en ai parlé aux acteurs. Il fallait que ça transpire, que ça passe par les corps. Celle qui se construit avec Sandrine s’est insinuée au fur et à mesure du tournage, comme une violence supplémentaire faite à la jeune femme ; une menace sourde qui constituerait un obstacle de plus à sa quête de liberté. Après la nuit passée sur l’autoroute et quoiqu’elle ait appelé Pierre à l’aide, c’est au secours d’Henri qu’elle vole quand les deux hommes se sautent à la gorge. Il transpire quelque chose de volontairement sensuel dans la scène où elle le soigne : elle lui passe la main dans les cheveux, il lui caresse délicatement la sienne… Dans la scène suivante, il la couche sur le bureau en menaçant de l’étrangler. On est en droit d'y voir des images suggestives !
Pour lire la suite de l'interview cliquez ici.

Louise Bourgoin, qui interprète Sandrine, est, pour beaucoup, à l’origine du film.
Elle était venue voir un de mes spectacles au théâtre et j’ai découvert quelqu’un de très différent de la projection que je m'en étais faite. Nous sommes devenus amis. Elle et moi venons du même milieu social. Mes préoccupations faisaient écho en elle. J’ai vraiment écrit mon scénario en pensant à Louise : je pressentais qu’elle avait une colère à exprimer qu’on ne lui avait encore jamais vue à l’époque au cinéma.
Etait-elle au courant de votre projet ?
Je ne voulais pas qu’elle se sente obligée de quoi que ce soit. Elle m’a demandé d’en lire une version un jour et m’a rappelé, enthousiaste. C’est seulement là que je lui ai avoué avoir écrit le rôle pour elle. "Je n’osais pas l’espérer," m’a-t-elle dit. Je pensais que la comédienne à qui tu donnerais ce rôle aurait beaucoup de chance. C’est moi qui suis chanceux. Louise a un instinct de jeu absolument dingue.
Vous êtes très économe de dialogues.
Je ne les utilise qu’en dernier recours. Je travaille beaucoup la structure de mes films : pour moi, le sens et l’émotion doivent naître des images et de la collision d’une scène avec une autre. Quand mes personnages parlent, c’est uniquement pour évoquer des questions concrètes, pas pour étaler leurs états d’âme.
Le son et la musique jouent également un rôle très important.
Le son est au diapason de ce que traversent intérieurement les protagonistes : leur tension se matérialise par des stridences, des sons étouffés ou saturés qui viennent court-circuiter les rumeurs de la vie normale. Avec Martin Wheeler, qui a composé la musique du film, nous voulions trouver une mélodie qui adhère étroitement au chemin que se fraye Sandrine pour sortir du chaos où elle se trouve : la clarinette basse, qui est utilisée dans le film, apporte la gravité, le souffle et l’élan qui la caractérise.
Pourquoi avoir souhaité mettre Quand revient la nuit, cette chanson des années soixante de Johnny Hallyday qui inspire le titre du film ?
C’est toujours cette idée d’introduire un moment de légèreté au milieu de l’âpreté des événements. J’avais envie d’une pause musicale et j’ai été séduit par cette mélodie et la voix qu’a Johnny Hallyday à cette époque. Et puis le texte parle de lui-même.

Mon opinion
Tout le contraire de ce à quoi je m'attendais.
Pour son premier long-métrage, Laurent Larivière saura éviter avec une grande subtilité une cruauté visuelle trop appuyée. Il est bien question de ce monstrueux trafic de chiots, en provenance des pays de l'Est, qui transitent via la Belgique.
Les mauvais traitements, les fraudes qui s'en suivent, et l'enrichissement scandaleux pour les trafiquants, seront l'un des points cruciaux du film. Le scénariste réalisateur met tout son talent dans une étude approfondie et soignée des principaux personnages. Deux mondes qui se côtoient. Deux univers opposés dans lesquels se mêlent des situations écœurantes pour certaines, d'honnêteté, voire de candeur pour d'autres.
Nous découvrirons tour à tour leurs failles, leurs qualités, leurs peurs, leurs souffrances. L'espoir d'une autre vie, aussi.
Sandrine, étonnante Louise Bourgoin se trouvera, d'une part, confrontée au questionnement d'une mère bienveillante et quelque peu crédule. D'autre part elle fera face à un oncle enrichi à l'insu de toute sa famille, par cet horrible trafic. Un oncle qui tente de racheter sa conduite maffieuse derrière une belle apparence, celle d'un frère et d'un oncle parfait. Un homme qui se voudrait respectable. Il fera preuve de bienveillance, voire d'une belle générosité financière envers sa famille dans le besoin. L'urgence dans laquelle celle-ci se trouve la rend peu scrupuleuse devant cette prétendue générosité. Dans ce rôle, Jean-Hugues Anglade est remarquable.
Pour ce premier long-métrage, et un casting parfait, Laurent Larivière frappe un grand coup !














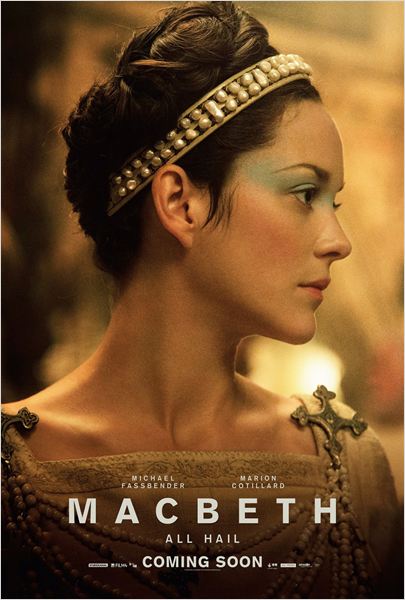



/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_660a9b_322344.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_d10974_336540.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_f394af_324135.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_399b3d_229450.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_e9b547_326635.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_c3a64a_323354.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_4a9cb9_181423.jpg)
/image%2F1387651%2F20151115%2Fob_8a0f37_598199.jpg)





/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_19b413_une-histoire-de-fou.jpg)
/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_c75a96_une-histoire-de-fou.jpg)
/image%2F1387651%2F20151111%2Fob_ca89c1_une-histoire-de-fou.jpg)