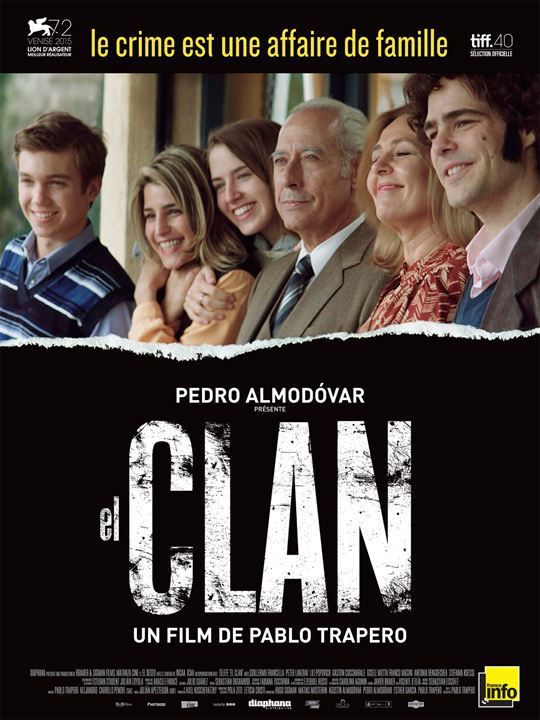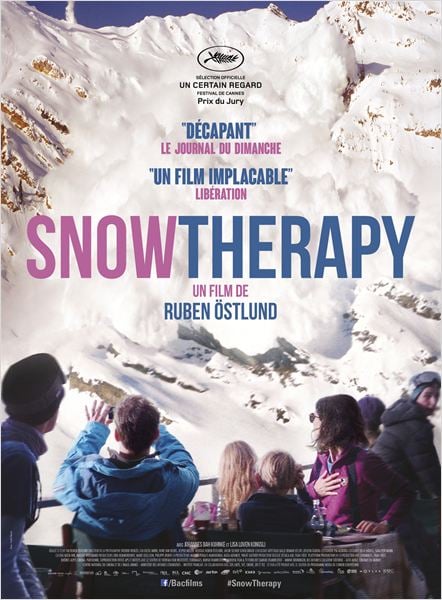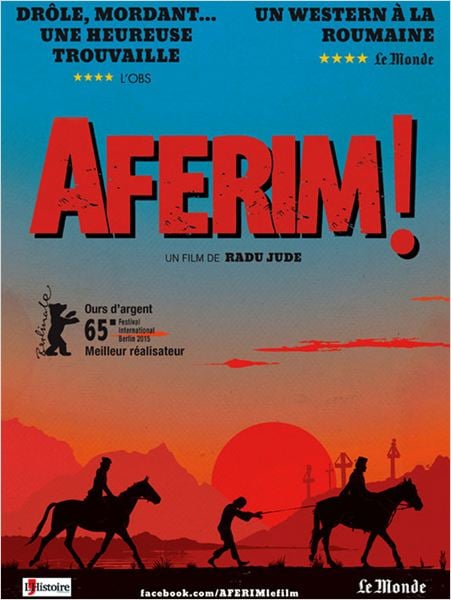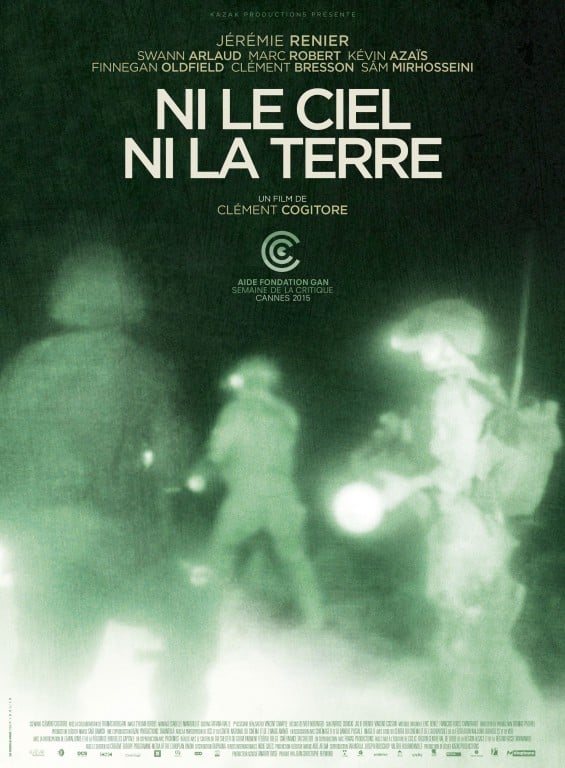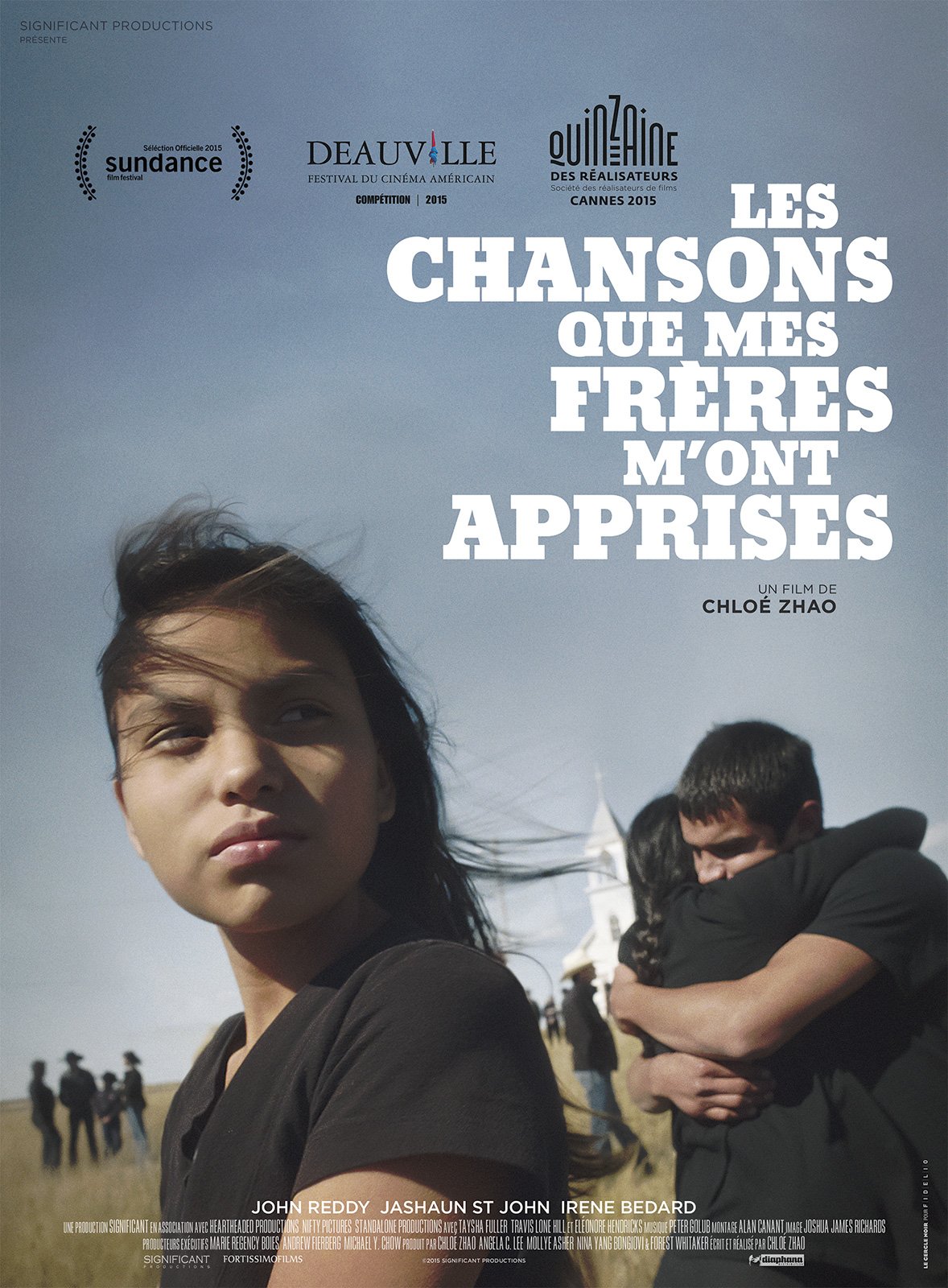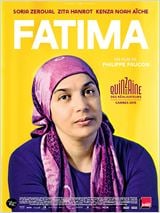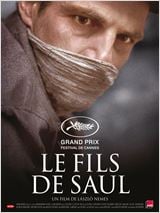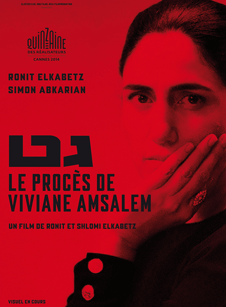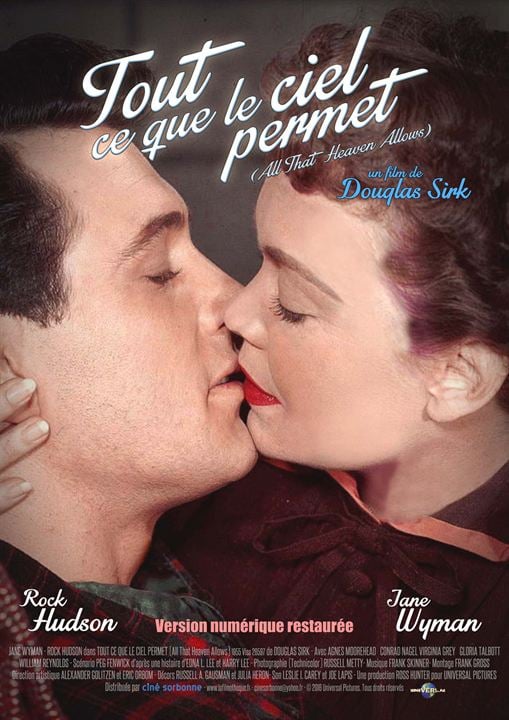Date de sortie 28 septembre 2016

Réalisé par Kleber Mendonça Filho
Avec Sonia Braga,
Maeve Jinkings, Irandhir Santos, Humberto Carrão, Zoraide Coleto, Buda Lira
Genres Drame
Productions Brésilienne, Française
Synopsis
Clara (, la soixantaine, ancienne critique musicale, est née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil.
Elle vit dans un immeuble singulier, l'Aquarius construit dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan.
Un important promoteur a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien.
Elle va rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle.
Très perturbée par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

Né en 1968, Kleber Mendonça Filho vit actuellement à Recife au Nord-Est du Brésil où il a passé son enfance.
Après ses études, Kleber a été engagé par le Jornal do Commercio. Au cours de sa carrière de journaliste, il écrit occasionnellement pour la Folha de S. Paulo et d’autres publications.
Dans les années 1990, Mendonça réalise principalement des documentaires en vidéo et des courts-métrages expérimentaux.
Ses films sont produits par CinemaScópio, sa propre société de production.
En 2012, il réalise Les bruits de Récife, son premier long-métrage de fiction.
Entretien avec
Propos recueillis par Tatiana Monassa et relevés dans le dossier de presse.
Comment est né ce projet ? Quel était l’élément déclencheur de l’histoire ?
Au départ, je voulais faire un film sur des archives, et Aquarius est peut-être un premier pas vers un autre film sur le goût de conserver des objets et sur la divergence entre les documents et les souvenirs. Il m’a semblé intéressant d’avoir comme protagonistes une personne et un immeuble ayant tous les deux à peu près le même âge et se trouvant d’une certaine manière menacés. Le film est né d’une série d’évènements, dont un assez banal : un flot d’appels téléphoniques reçus chez moi. Des appels publicitaires voulant vendre toutes sortes de souscriptions : cartes de crédit, mutuelles, abonnements télé ou presse. Je l’ai ressenti comme une attaque du marché, pour forcer les gens à acheter ce qu’ils ne désirent pas.
À partir de cette idée d’une attaque du marché, le film commente de manière directe, quoique assez subtile, la vague de spéculation immobilière qui s’est emparée de Recife ces dernières années. Mais au lieu d’aborder le problème de façon ouvertement politique, vous préférez vous concentrer sur les effets psychologiques chez le citoyen ordinaire.
En effet, le type de poursuite que je viens de décrire est particulièrement agressif dans le cadre du marché immobilier, et avant que la crise économique ne touche le Brésil, ils se comportaient comme des bêtes affamées. Le ballet de tracteurs et pelleteuses que j’ai pu voir à Recife était triste, mais fascinant aussi. Je me souviens d’avoir assisté au devenir d’une maison et de ses propriétaires. J’avais assisté à leur déménagement, ensuite j’ai remarqué un panneau qui annonçait un nouveau bâtiment ; quelques mois plus tard, j’ai vu un tracteur qui achevait de raser le terrain où cette maison avait existé pendant des décennies, et que quelques heures avaient suffi pour détruire.
 .
.
Dans mes films, j’applique cette logique, celle de témoigner des changements en fixant un point de vue lié au cadre de la vie personnelle. Ainsi, dans Aquarius, Clara comprend petit à petit ce que subissent son espace et son environnement personnel.
Cet affrontement se révèle être aussi un conflit de valeurs entre des styles de vie différents : d’un côté l’ultra-contemporain, modelé par la consommation haut de gamme et l’aseptisation généralisée, et de l’autre celui d’une génération antérieure, reposant plutôt sur un "savoir-vivre" et le goût de la communauté. S’agit-il d’un conflit qui vous touche ?
De fait, il s’agit d’une tension intéressante dans le film mais, dans ma vie, je vis ce conflit avec sérénité et irritation. Comment peut-on démolir aussi librement autant de maisons et d’immeubles qui ont une histoire, qui sont des références pour beaucoup de monde ?
À Recife, la ville a été totalement remodelée dans son modus operandi par les exigences du marché, et rien n’a été fait pour protéger la ville des intérêts commerciaux. J’entends toujours que le Brésil est un jeune pays, qui n’a pas le même attachement à l’Histoire comme l’on peut voir en Europe. C’est absurde, car une ville comme Recife, qui a environ cinq cents ans, a une longue histoire. Et la spéculation immobilière semble avoir réussi à détruire une partie importante de grandes capitales brésiliennes pour offrir des nouvelles constructions qui obéissent à un certain design et promouvoir une idée du renouveau, en effaçant le "vieux".
Finalement, avec , on revient à l’idée d’un film sur les archives, qu’elles soient matérielles ou affectives.
Dans votre film précédent, , on retrouvait déjà cette attention à la construction d’un microcosme complexe, avec les différentes relations d’affect et de pouvoir qui l’habitent. Est-ce pour vous une manière privilégiée d’aborder les questions politiques, sociales et historiques propres au Brésil ?
Je pense qu’on ne peut pas représenter la vie et les actions quotidiennes sans mettre en lumière leurs contradictions, qui peuvent être intéressantes, drolatiques ou sinistres. En fait, dans l’écriture de mes films, il m’est difficile d’ignorer ces aspects de la société, et notamment de la société brésilienne. Aussi, ai-je toujours été frappé par les contradictions idéologiques des Brésiliens issus des classes sociales aisées : ils peuvent avoir une posture aristocratique et en même temps soutenir l’abolitionnisme et des valeurs de gauche… En somme, mon défi est de chercher à représenter cette société dans sa complexité.
Les méthodes agressives du management contemporain, fondées sur la manipulation émotionnelle et pouvant aller jusqu’au harcèlement moral, sont mises en oeuvre de manière presque métaphorique dans le film, avec ces différents types d’offensives indirectes qui frôlent l’absurdité. Petit à petit, il s’opère un décollement de la réalité, et on va jusqu’à se demander si ce cauchemar n’est pas un délire de Clara.
Le cauchemar de Clara est tout d’abord réel. Il s’agit de se voir seule dans une situation très inconfortable, où elle subit une forte pression pour le simple fait d’être chez elle, là où elle a toujours habité. Elle a le sentiment que quelqu’un a subitement décidé que son espace n’a plus aucune valeur, qu’il est démodé et qu’on doit s’en débarrasser. Confrontée à des opinions contraires aux siennes, y compris au sein de sa propre famille, Clara craint, par moments, de perdre la raison. Son état d’esprit est fragilisé, ce qui ouvre la porte à des sentiments déstabilisants. J’aime l’idée que cela nous mène vers le mystère et le doute, comme un cauchemar lucide.
Votre flirt avec le fantastique et le cinéma de genre s’insinue par moments, avec des scènes qui suggèrent un fort sentiment de peur, bien qu’on ne puisse pas en préciser l’origine ou la raison.
D’une certaine manière, Aquarius évoque le genre du "siege movie" (films autour d’un état de siège), mais sans tirs, ni arcs et flèches, ni cocktails Molotov – du moins pas littéralement. L’immeuble Aquarius et l’appartement de Clara lui-même sont des aires définies (les portes, les murs, la cour), et se trouvent face au risque d’une invasion externe. Le bâtiment est constamment violé et l’appartement, la partie plus intime de cet univers, subit des menaces. Les fenêtres ouvertes dégagent aussi ce sentiment-là, car il s’agit d’un élément classique à mes yeux, celui de l’extérieur/intérieur. Et il y aussi le fait malheureux qu’au Brésil les fenêtres ouvertes nous rappellent cette pratique sociale établie qui consiste à mettre des clôtures sur toutes les fenêtres, à n’importe quel étage, pour éviter toutes sortes d’effractions.

.
Je pense donc que tous les éléments du film sont ordinaires, courants, mais il y a sans doute quelque chose dans le cadrage et dans le découpage qui renforce ce ton fantastique apparent.
Clara, interprétée par Sonia Braga, a-t-elle toujours été l’axe principal de l’histoire ?
L’idée a toujours été celle-ci : une femme, la soixantaine, veuve, propriétaire d’un très beau et simple appartement dans un vieil immeuble. Et je n’ai jamais voulu créer une structure en montage alterné, qui nous montrerait les bureaux de l’entreprise immobilière, ou alors Diego, le jeune entrepreneur, dans sa vie personnelle, ou bien participant à une réunion avec ses collaborateurs. Dès le début de l’écriture du scénario, le film était consacré à Clara, on devait être avec elle, et le point de vue du cadre est, la plupart du temps, le sien. Le contact qu’on peut avoir avec les autres se produit par son intermédiaire, par le fait qu’ils viennent frapper à sa porte ou lui parler, ou encore parce qu’elle dirige la parole à quelqu’un. Être collé au personnage de Clara est ce qui permet de générer une sensation d’instabilité ou d’insécurité.
Comment en êtes-vous arrivé à Sonia Braga pour le rôle de Clara ? Pensiez-vous déjà à elle en écrivant le scénario ?
Non. En écrivant le scénario, j’envisageais de découvrir une femme inconnue qui puisse jouer Clara. Nous étions prêts à nous lancer dans la production quand Pedro Sotero (co-directeur de la photographie d’Aquarius) a suggéré Sonia Braga. Alors Marcelo Caetano, notre directeur de casting, a envoyé le scénario à Sonia aux États-Unis. Elle a répondu sous 48 heures en signalant qu’elle voulait faire le film. Je suis allé à New York faire sa connaissance, et je l’ai adorée. L’une des plus belles choses dans tout ça, c’est que Sonia faisait déjà partie de ma vie, comme c’est souvent le cas avec les grands artistes, et elle est devenue une collaboratrice, puis une amie aussi.
Elle est souvent associée à une image de "sex symbol", grâce à une série de rôles de femmes très libérées sexuellement. Est-ce que son image publique a joué un rôle dans la construction du personnage ?
Je n’ai pas vraiment songé à la Sonia "sex symbol", car pour moi Sonia est avant tout un visage puissant de la culture brésilienne et aussi elle a une image d’une beauté inoubliable. Ça m’intéressait donc de ramener cette star à une situation dramatique réaliste, où sa beauté est d’ailleurs convoquée et participe d’une certaine manière au récit.

Sonia Braga commence sa carrière d’actrice en 1968, dans le film O Bandido da Luz Vermelha mais ce sont les télénovélas qui vont lui permettre de se faire connaître du grand public.
En 1976, Dona Flor et ses deux maris de Bruno Barreto la fait connaître du public international. Dans les années 1980, Sonia Braga entame une carrière à Hollywood et tournera pour Robert Redford ou encore Clint Easwood.
On la verra aussi à la télévision américaine, notamment dans Sex and the city.
Après avoir présenté Milagro en 1988 à Cannes, elle revient 28 ans plus tard avec Aquarius, le second long-métrage de fiction de Kleber Mendonça Filho.
Toute sa filmographie, cliquez ici.
 Pour fêter dignement ses 65 ans, l’actrice a posté en juin 2015 sur Facebook "les choses ne font que commencer". Je n’imaginais pas qu’effectivement, grâce à Kleber, c’était le début d’une nouvelle vie", explique-t-elle, extatique, en anglais. Selon elle et on ne la contredira pas, les femmes dans la vie comme à l’écran sont souvent dédaignées après une date de péremption supposée. "Alors que les hommes se bonifient, comme le vin", déplore-t-elle en riant. Il y a aussi la ménopause, qu’elle mentionne au détour d’une phrase, très enthousiaste : "I love it ! C’est un tabou. Vous devriez essayer !" On lui répond qu’on a hâte. Intarissable sur le crudivorisme, elle tentera de nous convertir à ce "bonheur corporel". Lors de la projection cannoise, l’équipe du film arborait sur le tapis rouge des pancartes dénonçant la destitution de la présidente Dilma Rousseff comme un coup d’État.
Pour fêter dignement ses 65 ans, l’actrice a posté en juin 2015 sur Facebook "les choses ne font que commencer". Je n’imaginais pas qu’effectivement, grâce à Kleber, c’était le début d’une nouvelle vie", explique-t-elle, extatique, en anglais. Selon elle et on ne la contredira pas, les femmes dans la vie comme à l’écran sont souvent dédaignées après une date de péremption supposée. "Alors que les hommes se bonifient, comme le vin", déplore-t-elle en riant. Il y a aussi la ménopause, qu’elle mentionne au détour d’une phrase, très enthousiaste : "I love it ! C’est un tabou. Vous devriez essayer !" On lui répond qu’on a hâte. Intarissable sur le crudivorisme, elle tentera de nous convertir à ce "bonheur corporel". Lors de la projection cannoise, l’équipe du film arborait sur le tapis rouge des pancartes dénonçant la destitution de la présidente Dilma Rousseff comme un coup d’État.
Sonia Braga a levé le poing à l’unisson. Aquarius, tourné il y a un an, agit comme une chambre d’échos annonciatrice de l’actualité : "Le Brésil n’a jamais été aussi divisé socialement, c’est choquant. Je viens des sixties - elle se reprend - enfin des fifties", en partant dans un éclat de rire...
Pour lire la suite de l'article de Clémentine Gallot
relevé sur next.liberation.fr, cliquez ici.
Le film consacre un rôle important à la musique, qui module les différents états d’esprit de Clara et finit par constituer un personnage à part entière. Comment avez-vous pensé ce rapport dynamique entre la narration et les différents styles de musique convoqués ?
J’aime le fait que Clara ait des vinyles chez elle – peut-être parce que, pendant 40 ans, elle les a achetés, ou alors reçus grâce à son travail de journaliste. J’aime également l’idée que, même si elle possède ces disques, elle ne renonce pas à écouter des morceaux sur son portable. Il était donc naturel que, du fait qu’elle écoute de la musique, cette musique remplisse la scène. La musique nous informe aussi sur ses goûts et ses états d’âme.
Le titre du film est le nom de l’immeuble, ce qui renforce l’idée que le lieu de l’action est le point d’ancrage du récit. Comment définiriez-vous votre rapport à l’esace en tant que cinéaste ?
Pour moi la question de l’espace est liée à la quantité d’information qu’on transmet, ou qu’on veut transmettre, au moyen du découpage et du choix du cadre. L’immeuble a toujours été un personnage dans le film, et mon défi était de le présenter subtilement comme ayant une certaine dignité : un immeuble un peu plus ancien, mais déjà condamné. Il était important qu’il n’ait pas l’air décadent ou précaire, c’est-à-dire qu’il soit un accusé innocent, et que ce soit clair dans le film que ses problèmes venaient du dehors et non pas de l’intérieur, de sa structure. Aussi, dans une sorte de jeu avec le spectateur, fallait-il montrer l’appartement de Clara d’une façon suffisamment précise pour qu’en voyant le film on soit capable de dessiner le plan de l’appartement sur un bout de papier, l’utilisation d’un vrai appartement pour le tournage m’a beaucoup fait réfléchir à l’espace lui-même et à ses contraintes. Car les besoins d’un film, comme les angles de prise de vue et l’emploi des fenêtres et des portes, ouvrent une série de difficultés concrètes qui nous révèle des idées nouvelles sur l’espace réel et sur l’espace cinématographique.
Le film s’achève sur un effet de choc pour le spectateur. Pourriez-vous commenter ce choix ?
J’avais écrit deux autres fins, mais je ne les ai pas filmées. Elles étaient intéressantes, mais le style était plus proche de quelque chose comme "la fin de la petite histoire" : les conflits se trouvaient plus ou moins résolus, on comprenait assez bien ce qui s’était passé ou pas passé. Parfois, on est captivé par un film et par sa personnalité artistique et la fin nous donne ce sentiment d’avoir atteint la conclusion de la petite histoire et rien d’autre. Cela m’ennuie. Ce n’est rien de dramatique, puisque bon nombre de ces fins fonctionnent, il s’agit juste d’une déception personnelle. Mais il y a un autre type de fins de films, plus difficile à expliquer ou encore à soutenir, où certaines questions n’ont pas de réponses, où il survient quelque chose de rude et le film se termine. Je me souviens toujours de la fin de Massacre à la tronçonneuse (Tobe Hooper, 1974), où ce grand homme masqué fait un ballet dément, atterrant, en accélérant sa tronçonneuse hyper bruyante, avec un lever de soleil orangé derrière lui. Cette fin laisse beaucoup de questions sans réponses : on ne part pas avec la fille qui a pu se sauver, la police n’arrive pas sur les lieux, on ne voit pas d’ambulances, la tronçonneuse ne vient pas à manquer d’essence… Mais c’est une fin qui fonctionne très bien avec le passage au noir ensuite. Dans le cas d’Aquarius, c’était une décision prise au montage, car on a estimé que la dernière scène représentait un saut dramatique assez important pour Clara dans l’histoire. Par ailleurs, j’aime les trois derniers plans et leur rapport aux premières images du film.

Mon opinion
Une grande chance d'avoir pu voir ce film de plus de deux heures.
Comme pour son premier long-métrage, le metteur en scène et scénariste, Kleber Mendonça Filho, choisit Recife, sa ville natale, comme décor.
Son scénario parfaitement écrit et délicat est d'une belle élégance. Attendrissant, aussi, sans jamais, être larmoyant. Les nombreux thèmes brassés dans le récit, trouvent tous leur juste place, dans une réalisation impeccable. "Il m’a semblé intéressant d’avoir comme protagonistes une personne et un immeuble ayant tous les deux à peu près le même âge et se trouvant d’une certaine manière menacés." A déclaré le réalisateur.
La mise en scène, allie finesse et dextérité. L'ensemble est fascinant et magnifique. Les dialogues, la photographie et la bande son viennent compléter cette belle réussite.
Avec un grand plus, Sonia Braga dans le rôle principal. "Visage puissant de la culture brésilienne et d'une beauté inoubliable", pour reprendre les mots du réalisateur. Une femme digne interprétée par cette prodigieuse actrice. Tour à tour belliqueuse, nostalgique voire arrogante quand il s'agit de défendre sa cause, elle reste ancrée dans sa vie de femme, son époque et marque les esprits.
Un grand coup de cœur pour ce film.











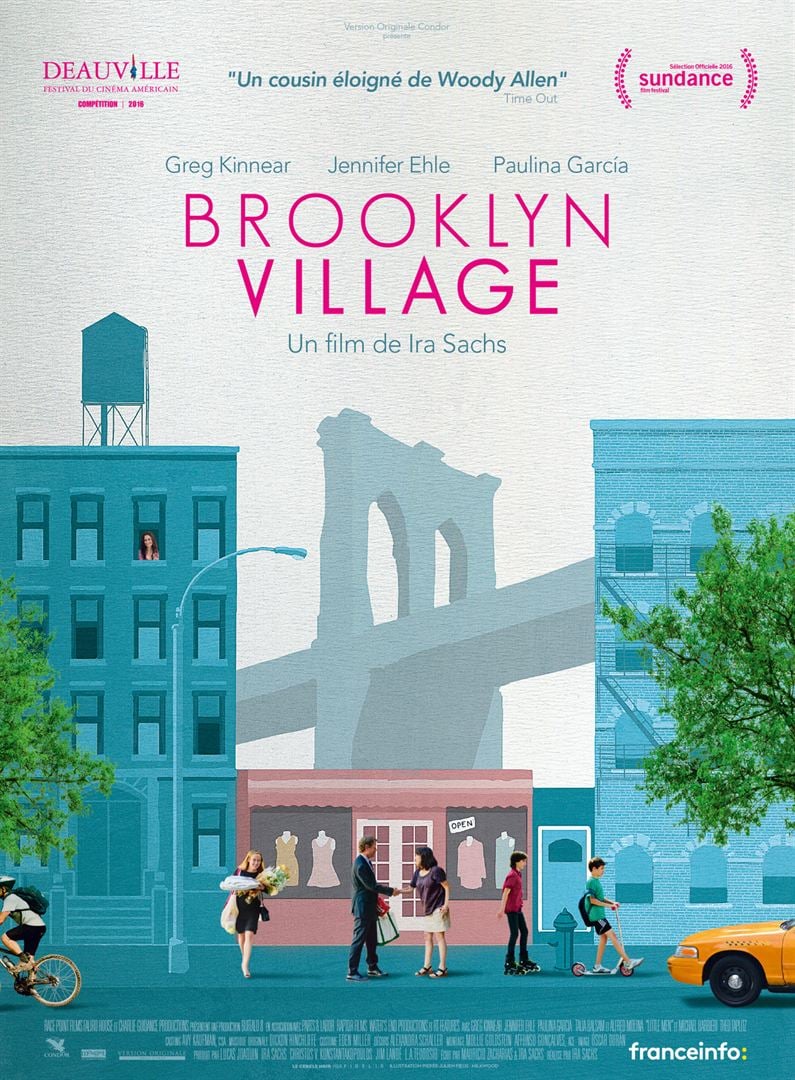







 Le fourgon est pris dans une manifestation chaotique. Ni les personnages, ni les spectateurs ne peuvent dire dans quel camp se situent les manifestants. L’ironie, c’est que les détenus se battent depuis le début pour sortir du fourgon et que là, face à la folie meurtrière, ils se retrouvent à s’entraider pour rester à l’intérieur.
Le fourgon est pris dans une manifestation chaotique. Ni les personnages, ni les spectateurs ne peuvent dire dans quel camp se situent les manifestants. L’ironie, c’est que les détenus se battent depuis le début pour sortir du fourgon et que là, face à la folie meurtrière, ils se retrouvent à s’entraider pour rester à l’intérieur.